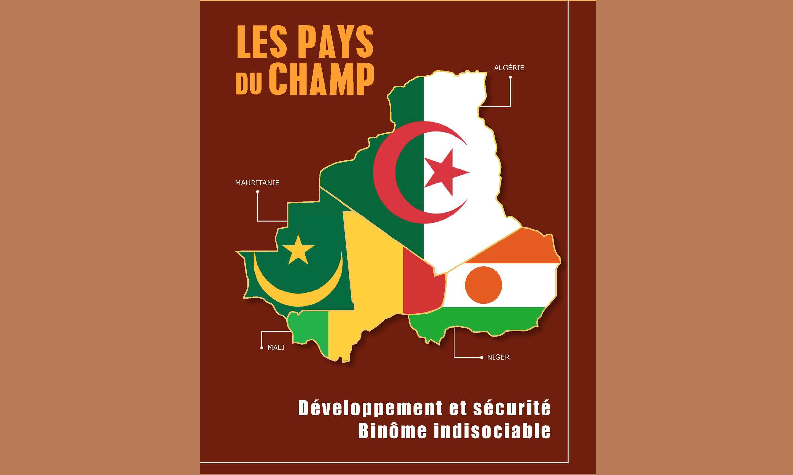Etiquettes : Algérie, catalan, Espagne, colonisation, France, empire ottaman,
Staoueli (territoire ottoman d’Algérie), 14 juin 1830. Les troupes françaises du général Bourmont entamaient la conquête du territoire. Par la suite, après vingt-sept années de combats (1830-1857) et trois cent mille morts des deux côtés (15000 Français et 285000 Algériens), la France finirait par incorporer un vaste territoire (la façade côtière de l’actuel État d’Algérie) qui serait morcelé, encadré et administré comme une région de plus de la métropole. Cette projection de territoire national sur la rive sud de la Méditerranée impulserait un phénomène inédit dans l’histoire africaine. Entre 1830 et 1914, l’État français a promu l’établissement de 750000 Européens en Algérie, dont au moins 30000 parlaient catalan, originaires du Roussillon, de Minorque et des régions intérieures d’Alicante : les pieds-noirs catalans.
La colonisation française
En 1830, lorsque Bourmont débarqua à Staoueli, la France était gouvernée par Charles X, petit frère de Louis XVI, le roi guillotiné pendant la Révolution (1793). Après les phases républicaine (1793-1804) et napoléonienne (1804-1815), les puissances qui avaient combattu et vaincu le « petit Corse » avaient imposé à la France la restauration de la monarchie et le retour des Bourbons (1815-1848). Et dans ce contexte politique clairement régressif, Paris projetait un plan ambitieux visant à résoudre trois problèmes en un coup : la crise économique, la dissidence politique et la contestation sociale. À ce moment-là, la colonisation des terres inconnues du continent américain appartenait déjà aux jeunes républiques américaines ; et Paris se dépêcha de dépoussiérer les cartes du Maghreb que, peu avant, l’espion catalan Domènec Badia (Ali Bey) avait dessinées pour Napoléon.
Pourquoi cette colonisation massive ?
Dès le début de la campagne, la chancellerie de Paris a clairement indiqué que la conquête de l’Algérie était plus qu’une simple entreprise coloniale comme celles du Québec et de la Louisiane (XVIe-XVIIIe siècles). La France n’avait jamais montré un intérêt particulier pour consolider un empire colonial en Amérique : le Québec avait été perdu aux mains des Britanniques (1763) et la Louisiane avait été vendue aux Américains (1804). Mais avec l’opération Algérie, les choses étaient très différentes : Paris a conçu un plan de colonisation qui représentait le débarquement de centaines de milliers d’Européens destinés à remplacer progressivement la population autochtone. Britanniques, Suédois, Allemands, Italiens et Espagnols (les Français étant toujours minoritaires dans l’ensemble de ce phénomène), devenus les cow-boys du Maghreb.
Les pionniers minorquins
La Minorque de 1830 était une triste ombre du « siècle d’or minorquin » qui l’avait précédée. Avec la fin de l’occupation britannique et le début de la domination espagnole (1802), la prospérité économique et culturelle s’était fanée à grands pas. Et dans ce contexte (une île surpeuplée avec une économie en ruine), l’émigration s’est révélée comme la seule issue. Les Minorquins furent les premiers Européens à participer à l’entreprise algérienne. La recherche historiographique révèle qu’entre 1830 et 1850, un contingent de 9 500 Minorquins (un tiers de la population de l’île) a émigré en Algérie française. On estime que finalement, environ 6 000 s’y sont établis. Dans une première phase (1830-1840), ce fut une émigration spontanée, qui s’explique par la relation historique et intense entre les armateurs provençaux et la société minorquine.
Fort de l’Eau et Ain Taya
Mais dans une deuxième phase, à partir de 1840, ce courant migratoire fut promu par les autorités françaises et conduit par un commerçant provençal nommé Jacques-Augustine de Vialar qui, pendant l’occupation, était devenu l’un des grands propriétaires terriens français en Algérie. Vialar créa deux villages de nouvelle plantation, exclusivement avec des Minorquins : Fort de l’Eau (1850) et Ain Taya (1855), fondés avec 260 et 960 colons, respectivement. Bien que le catalan n’ait jamais eu le statut de langue officielle (ni même de portée locale), Fort de l’Eau et Ain Taya seraient toujours catalanophones. Six générations de Minorquins et de descendants de Minorquins conserveraient la langue jusqu’à ce qu’avec l’indépendance de l’Algérie (1962), ils soient rapatriés en métropole et dispersés dans différentes régions de la côte méditerranéenne française.
Alger
En 1883, l’abbé Cinto Verdaguer visita le quartier européen d’Alger et consigna dans ses notes écrites que la population jeune d’origine roussillonnaise, minorquine et alicantine (les deuxième et troisième générations de l’émigration) utilisait le catalan comme langue véhiculaire. Et en 1885, Francesc Truyols, consul espagnol à Alger, quantifiait la population catalanophone de la capitale coloniale entre 20 000 et 30 000 personnes. Pour se faire une idée de ce que cela représentait, il faut savoir que Reus -à cette époque la deuxième ville de Catalogne- comptait 30 000 habitants. La communauté catalanophone d’Alger serait -en termes quantitatifs- la troisième dans le classement des communautés catalanophones à l’étranger, seulement dépassée par celles de La Havane (alors colonie espagnole de Cuba) et de Buenos Aires (République argentine).
À quoi se consacraient les « Catalans » d’Algérie ?
La distribution sur le terrain des colons (en grande partie guidée par l’administration française) révèle clairement l’activité économique de ces « Catalans ». Dans les zones rurales, comme c’était le cas des pionniers de Fort de l’Eau et Ain Taya, ils se consacraient à la production agricole. Les sources documentaires montrent qu’ils ont été bénéficiaires de l’État français avec la possession de vastes domaines sous la seule condition de les exploiter dans un court délai. Domaines qui, parfois, provenaient de lots de terres incultes, et d’autres fois, de confiscations à des propriétaires autochtones qui s’étaient rebellés contre la domination française. En revanche, dans les villes, surtout à Alger, ils étaient commerçants. L’une des boutiques qui acquit le plus de célébrité fut la boucherie Accault-Sintes, appartenant aux oncles maternels du prix Nobel de littérature Albert Camus Sintes.
Les bouchers Sintes et l’écrivain Albert Camus
La famille maternelle du philosophe et écrivain Albert Camus est l’un des exemples les plus emblématiques du phénomène catalanophone en Afrique du Nord. Miquel Sintes et Margarida Cursach (nés à Ciutadella en 1817 et en 1823, arrière-grands-parents maternels de Camus), furent les pionniers de cette aventure. Leur fils -et grand-père de Camus- Lluís, naquit déjà à Alger (1850), mais lorsqu’il fut temps de se marier, révélateur, il s’unit à Caterina Cardona Fedelich, née à Sant Lluís (1857), donc une émigrante minorquine de première génération. Lluís et Caterina eurent Caterina Sintes Cardona, la mère de Camus (1882), minorquine-algérienne de troisième génération. Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), Caterina devint veuve, et le jeune Albert, orphelin, fut élevé par les grands-parents Sintes et éduqué en « patuet », le nom familier donné au catalan en Algérie.
Le « patuet »
Camus n’écrivit jamais en catalan mais le parlait parfaitement. Camus, adulte, vécut et trouva la mort en France métropolitaine. Comme l’immense majorité des locuteurs de « patuet » qui, après la sanglante répression coloniale qui précéda l’indépendance algérienne (1962), durent quitter précipitamment leur maison, leur terre et leurs affaires. Ces catalanophones, qui avaient conservé la langue pendant six générations (un catalan, selon l’historien Ferran Soldevila, avec des tournures exotiques françaises, arabes et berbères) ; paradoxalement, rompirent la chaîne de transmission générationnelle en mettant les pieds sur la patrie de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Une culture qui, après six générations d’existence, de résistance et de transcendance, trouva la mort -comme Camus- sur une triste route de la France métropolitaine.
Source : El Nacional
#Algérie #Espagne #Turquie #France #EmpireOttoman #Staoueli