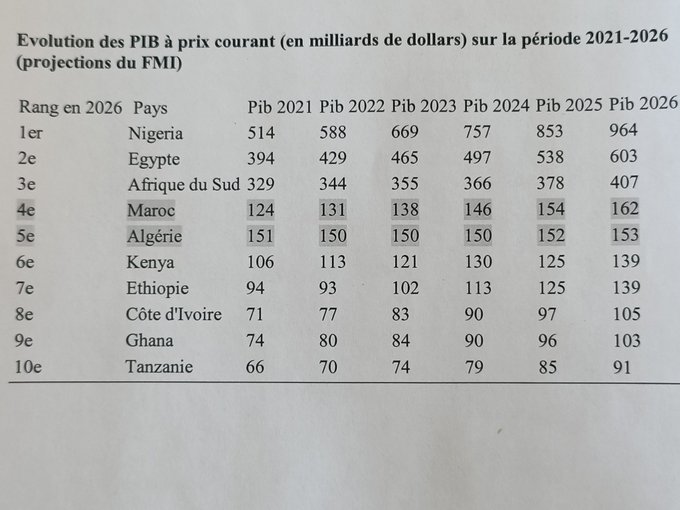Algérie: Le PLF 2022 tributaire de la rente des hydrocarbures – La loi de finances prévisionnelle 2022 se base sur un cours de 45 dollars le baril et un prix du marché de 50 dollars
La loi de finances prévisionnelle 2022 se base sur un cours de 45 dollars le baril et un prix du marché de 50 dollars, alors que pour le FMI, l’équilibre budgétaire pour 2022 nécessite plus de 150 dollars le baril, contre 141,3 dollars en 2021 et 83,6 pour 2020, rendant urgentes la rationalisation et des actions ciblées de la dépense.
1.- Le PLF 2022 prévoit des exportations des hydrocarbures de 32,4 mds de dollars fin 2021 et hors hydrocarbures à environ 5 milliards de dollars. Mais le document le plus fiable n’est pas la balance commerciale mais la balance des paiements qui inclut les sorties de devises des services donnant un déficit estimé à -5,3 mds de dollars (3.3% du PIB), contre -16,4 mds de dollars fin 2020, soit un recul de 67,5%. Le PLF 2022 table sur des recettes budgétaires qui s’élèvent à 5.683,22 milliards de dinars. Quant aux dépenses, le PLF 2022 prévoit un budget de fonctionnement de 6.311,53 milliards de dinars et un budget d’équipement de 3.546,90 milliards de dinars. Au total, nous avons des dépenses de 9.858,43 milliards de dinars donnant un déficit budgétaire de 4.175,21 milliards de dinars, soit au cours de 137 dinars un dollar 30,47 milliards de dollars alors que dans la loi de finances 2021, le déficit budgétaire était estimé à 2.784 milliards de dinars, soit 22 milliards de dollars au cours de 2020.
Pour les subventions, il est prévu 1.942 milliards de dinars, soit 19,7% du budget de l’Etat contre 24% en 2021 et 8,4% du PIB où en plus pour alimenter les caisses de retraite de retenir 3% de la taxe pétrolière, ce qui donne environ 63 milliards de dinars. Pour le gouvernement, ce déficit sera financé en recourant aux mécanismes du Trésor et au Fonds de régulation des recettes (différence entre le prix réel et 45 dollars) et ne recourra pas à la planche à billets ni à l’endettement extérieur, proposant de ne pas toucher au profit de Sonatrach et Sonelgaz afin de leur permettre de relancer l’investissement. Or, Sonelgaz ne fait pas de profit connaissant un déficit structurel d’environ 70 milliards de dinars pour 2020 qui a besoin, selon le rapport officiel du groupe et nécessitant entre 1,5 et 2,2 milliards de dollars/an au cours actuel entre 2021/2030 pour financer ses projets d’investissement et satisfaire la demande croissante en énergie. Quant à Sonatrach, en matière d’exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz, ses besoins en investissements pour les cinq prochaines années se situent entre 70/80 milliards de dollars. Mais pour la rentabilité de ces gisements, tout dépendra du vecteur prix au niveau international et du coût, pouvant découvrir des milliers de gisements non rentables, posant le problème de la rentabilité.
Avec la flambée du prix du gaz, qui connaît avec le coût du transport en Asie un cours dépassant les 30 dollars le MBTU, l’équivalent de 150 dollars le baril de pétrole, et entre 15/20 dollars en Europe et le cours du pétrole à plus de 85 dollars le Brent. A court terme, l’Algérie profite peu de ces hausses puisque selon le rapport de l’OPEP de juillet 2021, les exportations sont passées à plus de 1,2-1,5 million de barils/j, entre 2007/2008 à environ 450.000/500.000 barils/en octobre 2021, et pour le gaz, plus de 65 milliards de mètres cubes gazeux à 40 en 2020, espérant 43/44 pour 2021, du fait de la forte consommation intérieure, près de 40/50% de la production pour le pétrole et le gaz entre 2019/2020 et devant s’accélérer entre 2021/2030, laissant peu pour les exportations. Les études du ministère de l’Energie montrent clairement que la consommation intérieure horizon 2030 dépassera les exportations actuelles, d’où l’importance à la fois de revoir la politique des subventions des carburants, dossier très complexe, de développer les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique pour pouvoir honorer les engagements internationaux. C’est que l’Algérie ne s’est pas adaptée, faute de prévisions, aux nouvelles mutations gazières mondiales avec la percée du marché libre dit spot, ayant privilégié les contrats à moyen et long terme avec un prix fixe qui ne peut être révisé en cas de hausse ou baisse des prix qu’au bout d’une certaine période, après négociations.
Aussi, la remontée des prix pour 2021, étant prévu un cours moyen entre 70/80 dollars pour 2022) peut permettre une recette de Sonatrach entre 32/33 milliards de dollars, un gain de 6/8 milliards de dollars par rapport aux recettes de 2020, les opérateurs attendant toujours les décrets d’application de la loi des hydrocarbures et le code des investissements. Encore qu’il faille se méfier du juridisme, l’objectif étant de profondes réformes structurelles pour dynamiser l’économie. Aussi, il serait utile, ayant écarté l’endettement extérieur, restant les seules solutions, d’accroître la productivité et puiser dans les réserves de change, via les recettes de Sonatrach (98% des recettes en devises du pays avec les dérivés) en fonction de différents scénarios, d’évaluer les réserves évaluées au 01 janvier 2014 à 194 milliards de dollars, fin 2019 à 62 milliards de dollars, fin 2020, 48 et mai 2021 44 milliards de dollars.
2.-La loi de finances prévisionnelle PLF 2022 prévoit une dépréciation progressive du dinar par rapport au dollar, de 149,3 dinars un dollar en 2022, 156,8 en 2023 et 164,6 qui permet d’atténuer le montant de ce déficit budgétaire car si on avait un dollar à 100 dinars, il faudrait pondérer à la hausse d’au moins 37% le déficit, ce qui donnerait un montant supérieur à 42 milliards de dollars. Cela pose le problème du fait de l’extériorisation de l’économie algérienne dont le taux d’intégration ne dépasse pas 15% des impacts d’actions spéculatives sur les devises, sur le taux d’inflation et de l’opportunité du lancement de projets créateurs de valeur ajoutée dont le retour en capital est à moyen et long terme.
Cette dépréciation accélère la méfiance du citoyen vis-à-vis du dinar, amplifiant la sphère informelle, servant de soupapes sociales, qui représentent hors hydrocarbures plus de 50% de la superficie économique, idem pour l’emploi, et contrôlant une masse monétaire hors banques, selon les informations données par le président de la République lors de sa conférence de presse, du fait de l’effritement du système d’information, fin 2020 entre 6.100 et 10.000 milliards de dinars, soit au cours de 137 dinars un dollar entre 44,52 et 72,99 milliards de dollars. Les mesures adoptées via la finance islamique ont permis de drainer seulement 100 milliards de dinars, soit à peine 1% si l’on prend le montant de 10.000 milliards de dollars. (Voir étude sous la direction du Pr Abderrahmane Mebtoul pour l’Institut français des relations internationales -IFRI- Paris décembre 2013, les enjeux géostratégiques de la sphère informelle au Maghreb).
Avec le processus inflationniste interne où la majorité des produits importés, excepté ceux subventionnés, connaissent une hausse entre 50/100%, l’indice officiel de l’ONS non réactualisé depuis 2011, le besoin étant historiquement daté. Sans s’attaquer aux réformes, la vieille recette tant du Fonds de régulation (différence entre le prix du marché réel moyen de l’année et le prix fiscal de 45 dollars) étant un artifice comptable, vision purement monétariste qui n’a fait ses preuves par le passé et la dépréciation du dinar, sans réformes structurelles, il est impossible de dynamiser les exportations hors hydrocarbures. Pour preuve, la cotation du dinar a été de 5 dinars un dollar vers les années 1970, 70/75 dollars vers les années 1980, 90/120 dinars un dollar entre 2000/2018 et le cours le 01 novembre 2021 officiel selon la Banque d’Algérie à 136,884 dinars un dollar et 159,4727 un euro, avec un cours sur le marché parallèle le 31 octobre 2021 à 213 dinars un euro à la vente et 21.500 dinars à l’achat, sans dynamiser les exportations hors rente, le blocage étant d’ordre systémique.
Contrairement à certaines supputations, ignorant la pratique des relations internationales où n’existent pas de sentiments mais que des intérêts, avec la concurrence internationale, un des marché les plus difficiles à pénétrer supposant des entreprises publiques et privées compétitives en termes de coût/qualité, est l’Afrique où d’ailleurs l’on devra analyser les impacts de l’adhésion de l’Algérie à la zone de libre-échange avec le monde arabe, l’Afrique et pas seulement avec l’Union européenne qui nécessitent des dégrèvements tarifaires, l’adhésion à l’OMC dont les contraintes sont plus dures n’étant pas pour demain. Après analyse sur les 3,1 milliards de dollars hors hydrocarbures, pour les neuf premiers mois de 2021, le constat est que 75/80% sont constituées de dérivés d’hydrocarbures et de produits semi-bruts. L’important est d’avoir la balance devises nettes, devant soustraire les matières importées en devises, les exonérations fiscales, les matières subventionnées par l’Etat et aligner le prix de cession du gaz/pétrole sur le prix international pour voir si les entreprises sont compétitives en termes de coûts/qualité : plus de 85% des entreprises publiques et privées étant selon les données du registre du commerce, des unités personnelles ou petites Sarl peu compétitives.
3.- Le PLF 2022 prévoit une croissance de 3,3% et hors hydrocarbures de 3,7% à prix courants, un taux de croissance se calculant par rapport à la période précédente, un taux positif en 2021, rapporté à 2020, moins de 6% donnant un taux faible, en termes réels entre 0 et 1% largement inférieur à la croissance démographique. On ne peut tout restreindre, quitte à aller vers une dérive économique, uniquement pour le BTPH plus de 150.000 pertes d’emplois selon les organisations patronales, la majorité des unités fonctionnant à peine à 50% de leurs capacités, 85% des matières premières, entreprises publiques et privées fonctionnent avec des importations en devises. Il faudra tenir compte, avec la faiblesse du taux de croissance d’un indicateur souvent oublié, la pression démographique où la population active dépasse en 2021 12,5 millions sur une population totale résidente de 44,7 millions d’habitants au 1er janvier 2021 et du déficit financier de la Caisse nationale de retraite (CNR) qui devrait atteindre 690 milliards de dinars en 2021, le nombre de retraités dépassant les 3,3 millions, la CNR enregistrant un taux de cotisation de sécurité sociale, estimé à 2,2 travailleurs pour chaque retraité et pour un équilibre, le taux de cotisation devrait atteindre cinq travailleurs pour un retraité. C’est que la situation économique actuelle est complexe devant entre 2022-2025 créer plus de 350.000-400.000 emplois par an, qui s’ajoutent au taux de chômage, impliquant pendant plus de 5 à 7 ans un taux de croissance en termes réels entre 8/9%. Cela influe sur le taux de chômage, qui, selon le FMI, en 2021 serait de 14,1% et 14,7% en 2022 incluant les sureffectifs des administrations, entreprises publiques et l’emploi dans la sphère informelle.
L’Algérie possède encore des marges de manœuvre (voir notre interview quotidien gouvernemental Horizon 28/10/2021), mais de plus en en plus étroites, le ratio du service de la dette extérieure rapporté aux exportations de biens et services est estimé à 1% à fin 2020, le ratio du stock de la dette extérieure rapporté aux exportations était de 20% en 2020, contre 14% en 2019 et le ratio du stock de la dette extérieure rapporté au revenu national brut est estimé à 4% en 2020, à 3% en 2019. Mais selon la Banque mondiale, l’Algérie a peu attiré l’investissement étranger avec une baisse de 21,3%, 1,073 milliard de dollars en 2020, contre 1,364 milliard de dollars en 2019. Mais l’on devra éviter des promesses reposant sur l’utopie. Comment ne pas rappeler que l’Algérie a engrangé plus de 1.000 milliards de dollars en devises entre 2000/2019, avec une importation de biens et services toujours en devises de plus de 935 milliards de dollars pour un taux de croissance dérisoire de 2/3% en moyenne alors qu’il aurait dû être entre 9/10% et une sortie de devises de 20 milliards de dollars en 2020 pour une croissance négative selon le FMI de 6%.
Selon les données officielles du Premier ministère (source APS), l’assainissement du secteur public marchand durant les 25 dernières années a coûté au Trésor l’équivalent de 250 milliards de dollars et le coût des réévaluations entre 2005/2020, 8.900 milliards de dinars, soit au cours moyen de 135 dinars un dollar, environ 66 milliards de dollars : continuer sur cette voie est un suicide collectif. Evitons les utopies par un langage de vérité : si les projets du fer de Gara Djebilet et du phosphate de Tébessa commencent leur production en 2022, l’investissement de ces deux projets étant estimé à environ 15 milliards de dollars ainsi que le projet du gazoduc Algérie dont le coût est estimé par l’Europe, principal client, nécessitant son accord en plus des pays riverains, entre 19/20 milliards de dollars, la rentabilité ne se fera que dans 5/7 ans.
En conclusion, toutes les dépenses économiques et sociales prévues auront un impact sur les équilibres macroéconomiques de 2022 qui sont fonction des recettes des hydrocarbures qui, directement et indirectement via la dépense publique, irriguent une grande partie de la société. Malgré ses importantes potentialités, après plusieurs décennies d’indépendance politique en ce mois de novembre 2021, tant sur le plan économique que diplomatique, Sonatrach c’est toujours l’Algérie et l’Algérie c’est Sonatrach.
PR Abderrahmane MEBTOUL
Professeur des universités docteur d’Etat en sciences économiques 1974, expert international