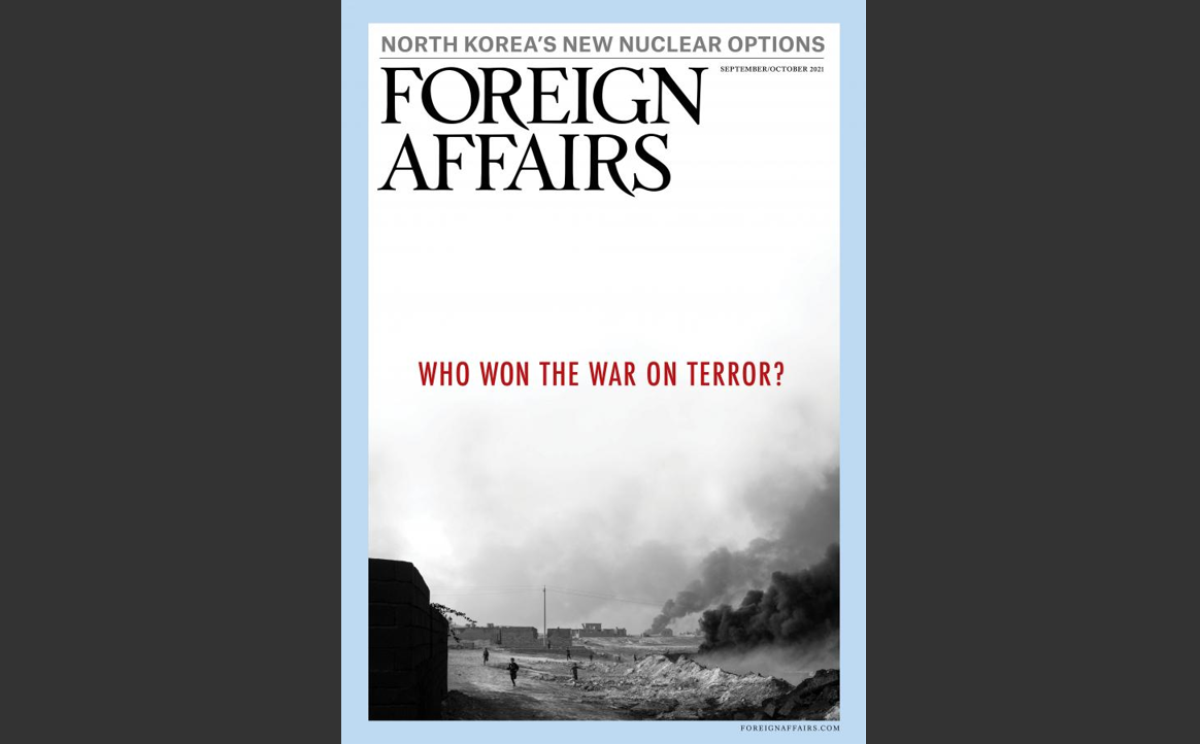Dans un camp en Syrie, des enfants oubliés sont façonnés par l’idéologie d’IS
AL-HOL, Syrie (AP) – Dans le camp tentaculaire d’al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, les enfants passent leurs journées à errer sur les chemins de terre, jouant avec des épées factices et des bannières noires en imitant les militants du groupe État islamique. Peu d’entre eux savent lire et écrire. Pour certains, la seule éducation qu’ils reçoivent est celle que leur donnent leurs mères en leur transmettant la propagande de l’État islamique.
Cela fait plus de deux ans que le « califat » autoproclamé du groupe État islamique a été renversé. Et cela fait plus de deux ans que quelque 27 000 enfants languissent dans le camp d’al-Hol, qui abrite des familles de membres de l’EI.
La plupart d’entre eux n’étant pas encore adolescents, ils passent leur enfance dans des conditions misérables, sans école, sans endroit pour jouer ou s’épanouir, et apparemment sans intérêt international pour résoudre leur situation.
Il ne reste qu’une seule institution pour les former : les vestiges du groupe État islamique. Les agents et les sympathisants de l’État islamique disposent de réseaux au sein du camp, et le groupe possède des cellules dormantes dans l’est de la Syrie qui continuent à mener une insurrection de bas niveau, attendant une occasion de renaissance.
Les autorités kurdes et les groupes d’aide craignent que le camp ne crée une nouvelle génération de militants. Ils implorent les pays d’origine de reprendre les femmes et les enfants. Le problème est que les gouvernements des pays d’origine considèrent souvent que les enfants représentent un danger plutôt qu’un besoin de secours.
« Ces enfants sont les premières victimes d’ISIS », a déclaré Sonia Khush, directrice de la réponse de Save the Children en Syrie. « Un garçon de 4 ans n’a pas vraiment d’idéologie. Il a des besoins de protection et d’apprentissage. «
« Les camps ne sont pas un endroit où les enfants peuvent vivre ou grandir », a-t-elle ajouté. « Cela ne leur permet pas d’apprendre, de socialiser ou d’être des enfants (…). Il ne leur permet pas de guérir de tout ce qu’ils ont vécu. »
Dans le camp clôturé, des rangées de tentes s’étendent sur près d’un kilomètre carré. Les conditions sont rudes. Les tentes sont inondées en hiver et des incendies se sont déclarés suite à l’utilisation de réchauds à gaz pour cuisiner ou se chauffer.
Quelque 50 000 Syriens et Irakiens y sont logés. Près de 20 000 d’entre eux sont des enfants. La plupart des autres sont des femmes, des épouses et des veuves de combattants.
Dans une section séparée et fortement surveillée du camp, connue sous le nom d’annexe, sont logées 2 000 autres femmes originaires de 57 autres pays, considérées comme les plus irréductibles partisans de l’EI, ainsi que leurs enfants, au nombre de 8 000.
L’influence de l’EI était évidente lors d’une rare visite de l’Associated Press au camp le mois dernier. Une douzaine de jeunes garçons de l’annexe ont jeté des pierres à l’équipe, qui était accompagnée de gardes kurdes. Quelques-uns ont brandi des morceaux de métal tranchants comme des épées.
« Nous allons vous tuer parce que vous êtes un infidèle », a crié un enfant qui semblait avoir environ 10 ans. « Tu es l’ennemi de Dieu. Nous sommes l’État islamique. Tu es un diable, et je vais te tuer avec un couteau. Je vais te faire exploser avec une grenade ».
Un autre enfant a fait glisser sa main sur son cou et a dit : « Avec le couteau, si Dieu le veut ».
Sur un marché à l’intérieur de l’annexe où des femmes vendaient du shampoing, des bouteilles d’eau et des vêtements usagés, une femme a regardé un journaliste et a dit : « L’État islamique perdure » – un slogan du groupe.
Au cours de son règne de près de cinq ans sur une grande partie de la Syrie et de l’Irak, l’État islamique a fait une priorité de l’endoctrinement des enfants dans son interprétation brutale de la loi islamique, dans le but de consolider son « califat ». Il a formé des enfants comme combattants, leur a appris à décapiter des poupées et leur a même fait tuer des prisonniers dans des vidéos de propagande.
Une femme russophone de l’annexe, qui s’est identifiée comme Madina Bakaraw, a déclaré qu’elle craignait pour l’avenir des enfants, dont son propre fils et sa propre fille.
« Nous voulons que nos enfants apprennent. Nos enfants devraient être capables de lire, d’écrire, de compter », a déclaré cette femme de 42 ans, entièrement couverte de noir, y compris le visage et les mains. Elle a déclaré que son mari était mort mais a refusé de dire comment. « Nous voulons rentrer chez nous et voulons que nos enfants aient une enfance ».
Les femmes du camp sont un mélange. Certaines restent dévouées à l’IS, mais d’autres ont été désillusionnées par son règne brutal ou par sa défaite. D’autres encore n’ont jamais été engagées idéologiquement mais ont été amenées dans le « califat » par leur mari ou leur famille.
Le camp a commencé à être utilisé pour loger les familles des combattants de l’EI à la fin de 2018, lorsque les forces kurdes soutenues par les États-Unis ont repris aux militants des territoires dans l’est de la Syrie. En mars 2019, elles se sont emparées des derniers villages tenus par IS, mettant fin au « califat » que le groupe a déclaré sur de grandes parties de l’Irak et de la Syrie en 2014.
Depuis lors, les administrateurs kurdes qui dirigent l’est de la Syrie se sont efforcés de rapatrier les résidents du camp face à l’opposition locale à leur retour ou en raison des craintes de vengeance des résidents eux-mêmes. Au début de cette année, des centaines de familles syriennes ont quitté le camp après qu’un accord ait été conclu avec leurs tribus pour les accepter. Le mois dernier, 100 familles irakiennes ont été rapatriées pour vivre dans un camp en Irak, mais elles sont toujours confrontées à une forte opposition de la part de leurs voisins.
Certains États de l’ancienne Union soviétique ont laissé revenir certains de leurs citoyens, mais d’autres pays arabes, européens et africains n’ont rapatrié qu’un nombre minime de personnes ou ont refusé.
« Ces enfants sont là sans aucune faute de leur part, et ils ne devraient pas payer les conséquences des choix de leurs parents », a déclaré à l’AP Ted Chaiban, directeur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de l’UNICEF, l’agence des Nations unies pour l’enfance. Chaiban a visité al-Hol en décembre.
L’administration dirigée par les Kurdes affirme qu’elle n’a pas les ressources nécessaires pour entretenir et garder le camp.
Si les pays d’origine ne veulent pas rapatrier les réfugiés, ils devraient au moins aider à mettre en place des installations pour améliorer la vie des enfants, a déclaré Shixmus Ehmed, chef du département des réfugiés et des personnes déplacées de l’administration.
« Nous avons suggéré que des écoles soient ouvertes, ainsi que des programmes de réhabilitation et des terrains pour faire du sport », a déclaré Ehmed. « Mais jusqu’à présent, il n’y a rien ».
Dans la section principale du camp, l’UNICEF et les autorités kurdes avaient mis en place 25 centres d’apprentissage, mais ils sont fermés depuis mars 2020 à cause du COVID-19. L’UNICEF et ses partenaires ont distribué des livres pour que les enfants puissent étudier par eux-mêmes.
Dans l’annexe, les autorités n’ont pas été en mesure de mettre en place des centres d’apprentissage. Au lieu de cela, les enfants y sont largement instruits par leurs mères, le plus souvent avec l’idéologie de l’IS, selon les responsables de l’ONU et kurdes.
Bien que les résidents de l’annexe soient considérés comme les plus fervents partisans de l’EI, le groupe est également présent dans la section principale, qui abrite des Syriens et des Irakiens.
À la fin du mois de mars, les forces dirigées par les Kurdes, assistées par les forces américaines, ont balayé le camp et capturé 125 personnes soupçonnées d’appartenir à l’EI, dont des Irakiens et des Syriens.
Ces cellules dormantes avaient mené une campagne de meurtres contre des résidents soupçonnés d’avoir abandonné l’idéologie du groupe, de travailler comme informateurs ou de défier ses règles, par exemple en se prostituant pour survivre. Au moins 47 personnes ont été tuées cette année, selon les forces dirigées par les Kurdes, tandis que les responsables américains avancent le chiffre de 60.
Une Syrienne qui a quitté le camp avec ses cinq petits-enfants au début de l’année a déclaré à l’AP qu’elle connaissait plusieurs femmes tuées pour s’être prostituées. Dans chaque cas, un homme masqué s’est présenté à la tente de la femme, s’est identifié comme un membre d’IS et a tiré sur la femme devant ses voisins ou même ses enfants, a-t-elle dit.
« Le lendemain matin, la nouvelle s’est répandue dans le camp », a-t-elle dit, parlant sous couvert d’anonymat pour sa sécurité.
Elle a ajouté qu’il était courant, même dans la partie principale du camp, de voir des enfants scander « l’État islamique perdure » et porter un bâton auquel est attaché un sac noir symbolisant le drapeau de l’EI.
Amal Mohammed, une Irakienne de 40 ans vivant dans le camp, a déclaré que son souhait était de retourner en Irak où ses filles pourraient vivre une vie normale.
« Quel est l’avenir de ces enfants ? » a-t-elle dit. « Elles n’auront pas d’avenir […] Ici, elles n’apprennent rien ».
Associated Press, 03 juin 2021
Etiquettes : Syrie, Al-Hol, camp, Daech, Etat islamique, terrorisme, intégrisme, radicalisation, kurdes,