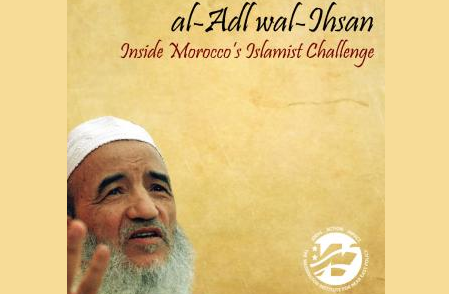Topics : Maroc, Yassine Mansouri, DGED, Mohammed VI, services secrets, renseignement,
Sa discrétion n’a d’égale que sa puissance. Renseignement intérieur, lutte anti-terroriste, affaires étrangères…
L’ombre du patron de la DGED est partout.
Voilà un personnage mystérieux. Depuis son passage au collège royal aux côtés du futur Mohammed VI, on sait que Mohamed Yassine Mansouri est extrêmement réservé, voire timide. Le genre à rougir légèrement les rares fois où il lui arrive de prendre la parole. Ses amis parlent d’un homme pieux (c’est un habitué de la Omra aux lieux saints de l’islam), attaché à ses origines. Lors de ses apparitions publiques, plutôt fréquentes pour un patron de services secrets, il étonne par sa simplicité et sa disponibilité. Ne l’a-t-on pas vu, par exemple, marcher lors de manifestations pro-palestiniennes, ou jouant des coudes lors de funérailles de grands hommes d’Etat ?
Ceux qui l’ont pratiqué s’arrêtent sur son flegme et sa prudence, parfois exagérée. “Il lui arrive de ne pas trancher sur des questions cruciales tant qu’il n’a pas reçu un feu vert d’en haut lieu”, se rappelle l’un de ses anciens collaborateurs au ministère de l’Intérieur. A la DGED (Direction générale des études et de la documentation, renseignements extérieurs ou contre espionnage), Mansouri n’a pas changé. Travailleur infatigable, il reste malgré tout proche de sa famille et de ses amis. Vaguement, on sait qu’il a rajeuni les équipes de l’agence et élargi son champ d’action, aussi bien au Maroc qu’à l’international. On sait aussi qu’il a fini par imposer la DGED comme une super-agence, qui semble de plus en plus, et c’est une grande nouveauté, coordonner l’action de tous les autres services de renseignement. Vrai ou faux ? Difficile de trancher, ou de confirmer cela auprès du premier intéressé, totalement injoignable. Mais une chose reste sûre, toutes les grandes affaires du royaume, ou presque, portent aujourd’hui l’empreinte de l’agence dirigée par l’enfant prodige de Bejaâd, son fief natal.
Il a surfé sur l’affaire Mustapha Salma
Dernier cas en date, celui de Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud. L’affaire de l’ex-policier indépendantiste n’a pas encore livré tous ses secrets. Il y a quelques semaines, le Front Polisario a certes annoncé sa libération. Mais Mustapha Salma demeure introuvable. Sa famille, aussi bien à Tindouf qu’au Maroc, n’a pas encore réussi à le localiser, encore moins à lui parler. Le Polisario aurait-il “bluffé” pour contenir la pression (grandissante) à l’international ? “Cela reste possible, analyse ce militant de gauche à Laâyoune. Mais alors, ils ont mal calculé leur coup parce que la mobilisation pour le cas Mustapha Salma a repris de plus belle. Parfois même avec plus d’intensité”. En fin de semaine dernière en effet, Human Rights Watch et Amnesty International ont fait part de leur “préoccupation” quant au cas du dissident sahraoui. “Le Polisario est dans une situation pour le moins inconfortable, poursuit notre militant. Le Front a d’abord abusivement arrêté un Sahraoui qui n’a fait qu’exprimer une opinion politique. Aujourd’hui, les responsables de l’organisation indépendantiste sont, de plus, soupçonnés d’avoir menti à la communauté internationale. De toute évidence, le Maroc marque des points dans la guerre médiatique et politique qui l’oppose au Polisario”. Derrière ce “coup”, se cache un homme : Yassine Mansouri, patron de la DGED.
Selon plusieurs sources qui suivent de très près l’affaire du Sahara, il a pris le temps de “travailler son dossier”. Avant d’organiser sa conférence de presse à Smara et de proclamer ouvertement sa préférence pour le plan d’autonomie marocain, Mustapha Salma a en effet tranquillement traversé le Maroc, du nord au sud. L’ex-responsable sahraoui aurait-il réussi à déjouer “la vigilance” des autorités marocaines ? La question fait sourire ce journaliste sahraoui. “Il a évidemment été fiché dès son entrée au Maroc, peut-être même avant, mais on l’a laissé tranquille. C’est lors de son deuxième séjour au royaume (en août) que les services de sécurité sont entrés en contact avec lui. Ils sont tombés sur une perle rare. Un Sahraoui suffisamment souple pour accepter de dialoguer, mais assez têtu pour tenter le diable, et revenir à Tindouf”, conclut le journaliste.
Dans cette affaire, comme dans plusieurs autres, difficile d’évaluer la part d’intervention de chaque service. Néanmoins, sur le terrain, le lobbying discret mais insistant et l’influence grandissante de la DGED ne font aucun doute. L’agence, théoriquement dédiée au renseignement à l’international, a peu à peu élargi son périmètre d’intervention à l’intérieur du territoire. “Il n’y a pas de mystère à cela, confie cet officier. Les thématiques sur lesquelles travaille la DGED, comme le Sahara, le terrorisme ou la lutte contre le trafic de drogue, ont des implications aussi bien au Maroc qu’à l’étranger”.
Ce n’est pas tout. Depuis le départ de Fouad Ali El Himma, confie-t-on, Mohamed Yassine Mansouri est devenu le nouvel homme fort de l’ensemble de l’appareil sécuritaire marocain. Une sorte de coordinateur général des différents services même si, selon certains de ses proches, l’ancien camarade de classe de Mohammed VI n’aime pas ce genre de classification. “En fait, explique notre source, c’est un poste qui n’existe pas officiellement. Fouad Ali El Himma l’a incarné au lendemain des attentats du 16 mai, le général Laânigri l’a certainement convoité en secret. Aujourd’hui, c’est au tour de Mansouri d’en hériter. Et force est de reconnaître qu’il a la tête de l’emploi”.
Il a un accès direct au roi
Réservé et discret, Mohamed Yassine Mansouri a d’abord toujours su se préserver des guerres secrètes, et souvent violentes, qui secouent le premier cercle royal. Il continue donc d’avoir un accès direct au monarque, ce qui lui confère une crédibilité certaine auprès de ses différents interlocuteurs. “Qu’ils soient acteurs politiques, dissidents sahraouis ou partenaires sécuritaires internationaux, tous savent qu’ils ont en face d’eux un émissaire privilégié et personnel du roi. Cela fait souvent la différence”, affirme un proche du patron de la DGED.
C’est ensuite un travailleur qui a patiemment fait son apprentissage du “métier”. D’abord aux côtés de Driss Basri puis sous Mohammed VI. Il a successivement été patron de la Direction des affaires générales (DAG) au ministère de l’Intérieur, puis directeur général de l’agence MAP avant d’atterrir dans la forteresse de la route de Rommani (siège de la DGED à Rabat). “Il a même effectué un stage au FBI sur recommandation personnelle de Hassan II”, confie un vieil ami de Mohamed Yassine Mansouri.
La carrière makhzénienne n’a pas empêché le fils de Bejaâd d’entretenir un vaste réseau politique. On le dit ainsi proche de plusieurs figures de la gauche marocaine comme Bensaid Aït Idder, dirigeant de l’OADP puis du PSU. L’homme dispose également de relais solides dans sa région natale, ainsi qu’au Sahara, voire même à Tindouf. Pour entretenir ce réseau, Mansouri n’hésite pas à s’offrir quelques “bains de foule politiques” à l’occasion d’évènements spéciaux, comme ce fut le cas lors des funérailles de Abdallah Ibrahim ou de Abdelaziz Meziane Belfqih.
Car contrairement à ce qu’on pourrait penser, sa nomination à la tête du contre-espionnage marocain ne l’a pas rendu invisible. Bien au contraire. Il est ainsi l’un des principaux négociateurs marocains dans l’affaire du Sahara. Il pose, sans complexes, aux côtés du secrétaire général de l’ONU et s’affiche publiquement lors des points de presse et des séances de briefing qui suivent les rounds de négociations entre le Maroc et le Polisario. “Mais alors, raconte un journaliste qui s’est déjà retrouvé à sa table, impossible de lui extirper la moindre information ou le moindre commentaire. Il arrive toujours à changer de sujet ou à vous retourner votre question, tout en restant poli et cordial”.
Au lendemain du putsch qui a renversé le président mauritanien Ould Cheikh Abdellahi en 2008, c’est encore lui que Mohammed VI dépêche officiellement à Nouakchott afin de sonder les intentions du nouveau chef de l’Etat. La capitale mauritanienne est d’ailleurs une véritable plaque tournante pour le renseignement marocain à l’étranger. Une sorte de hub africain de première importance. “Les agents de la DGED y ont d’ailleurs leurs habitudes depuis plusieurs années, confie cet entrepreneur mauritanien. Ils résident toujours dans le même hôtel, vont au même restaurant et gardent un œil sur tout ce qui se passe dans le pays. Mansouri se rend souvent sur place également”. Depuis 2005, le pays de Mohamed Ould Abdelaziz est, de plus, devenu une véritable tour de contrôle pour les équipes de la DGED, sérieusement préoccupées par les activités d’Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) dans la région du Sahel.
Il dialogue avec les Européens et les Américains
Si l’Algérie a fait le choix des armes pour lutter contre le réseau terroriste, le Maroc a privilégié, quant à lui, le renseignement. Une mission qui échoit naturellement à la DGED, dont les agents sont devenus habitués aux réunions sécuritaires mondiales au Mali ou au Niger. “Mansouri est fier que la DGED ait exprimé, la première, son inquiétude face aux risques terroristes dans cette région du monde, explique ce cadre au ministère de l’Intérieur. A l’époque, le Maroc a discrètement partagé les informations en sa possession avec les grandes puissances mondiales. Mansouri ne voulait pas trop en faire pour ne pas être taxé de chercher simplement à déstabiliser le Polisario et légitimer, d’une nouvelle manière, la souveraineté marocaine sur le Sahara”.
Aujourd’hui encore, l’intervention de la DGED dans ce dossier relève du secret-défense. En août 2010 par exemple, le ministre espagnol de l’Intérieur nous apprenait, presque par hasard, que le Maroc a fourni “une précieuse assistance” au royaume ibérique afin de libérer deux otages détenus par AQMI. “L’enjeu est important pour le royaume, analyse cet observateur sahraoui. D’un côté, ses services secrets donnent la preuve de leur efficacité. Les fichiers de combattants jihadistes qu’ils ont constitués au fil des années s’avèrent grandement utiles. De l’autre, le Maroc semble affirmer qu’AQMI ne pourra pas élargir ses activités au Sahara tant que ce dernier est sous souveraineté marocaine”. Au passage, Mohamed Yassine Mansouri devient un interlocuteur incontournable dans la région auprès des Européens et des Américains. On dit que ses visites sont assez fréquentes à Washington, où il disposerait d’entrées privilégiées au sein d’agences de renseignement de premier plan.
Et cela ne plaît pas forcément à tout le monde. L’Algérie ne rate par exemple aucune occasion de rappeler que le royaume ne dispose pas de frontières avec la région du Sahel. Il y a quelques semaines, le pays de Abdelaziz Bouteflika a même refusé de prendre part à une réunion de coordination sécuritaire au Mali pour protester contre la présence marocaine autour de la table de discussions. Une première ! “En fait, analyse notre observateur, l’Algérie n’arrive pas à digérer le fait que le Maroc, essentiellement à travers la DGED, soit devenu incontournable dans la gestion de dossiers sécuritaires régionaux et continentaux, après avoir sérieusement renforcé sa coopération économique et diplomatique avec plusieurs pays africains”.
Il partage, il fédère, il rassure
Reste une question : dans quelle mesure la DGED chapeaute-t-elle réellement, aujourd’hui, le travail des autres services de renseignement ? Difficile de répondre avec précision. Certes, chacun des services a ses propres prérogatives et son domaine d’intervention bien précis, “mais il n’est pas interdit de travailler ensemble. C’est même souhaitable”, ironise un proche de Mansouri.
Avec Si Yassine, comme certains l’appellent désormais, la guerre des services n’est (apparemment) plus qu’un lointain souvenir. “Du fait de sa proximité avec le roi et de la complexité des dossiers qu’il gère, il a souvent des informations à partager avec les autres. Le travail de la DAG ou de la DST n’a plus de secrets pour lui du fait de son long passage au ministère de l’Intérieur”, explique une source proche du milieu du renseignement. “Il n’est ni cassant ni rancunier, surenchérit ce journaliste qui l’a côtoyé à la MAP. Lorsqu’il a atterri à l’agence de presse, on avait tous parié sur un changement radical, des mises au placard à la pelle, etc. Il n’en fut rien. Il s’est installé dans le même bureau que son prédécesseur et a travaillé avec le même staff. C’est un homme qui déteste la brutalité et les règlements de compte”. Très vite, nous a-t-on assuré, les autres services ont compris qu’avec un profil pareil à la tête de la DGED, “ils gagneraient en efficacité sans perdre en indépendance”.
Autre avantage pour Mansouri : l’absence de concurrents influents ou charismatiques. A la DST par exemple, le général Laânigri, professionnel du renseignement, a été remplacé par Abdellatif Hammouchi, spécialiste de l’antiterrorisme. Capable de reproduire, de mémoire, l’architecture complexe de tous les groupuscules terroristes marocains, le numéro 1 de la DST reste néanmoins presque exclusivement concentré sur l’opérationnel et les actions de terrain. Ce n’est donc pas lui qui risque, vraiment, de voler la vedette au nouvel homme (de l’ombre) fort du royaume.
De plus, Mansouri a su entretenir des relations assez bonnes avec les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Avec lui, visiblement, les services, tous les services de Sa Majesté, gagnent visiblement en sérénité. “Lorsqu’on ne se marche pas dessus, l’efficacité suit toujours”, nous confie ce proche de Mansouri.
Perso. Un vrai chef de clan
Mohamed Yassine Mansouri a, depuis toujours, fui les mondanités et les endroits publics. Dès que son emploi de temps le lui permet, le chef de la DGED préfère plutôt rejoindre son épouse et ses quatre enfants. “Il lui arrive de passer les voir quelques minutes entre deux déplacements. C’est important pour son équilibre”, confie l’un de ses proches. Lors des grandes fêtes religieuses, c’est également chez lui que se réunit la grande famille. Durant ses déplacements à l’étranger, il lui arrive régulièrement de faire un saut chez ses nièces et neveux installés en Europe et aux Etats-Unis. Mohamed Yassine Mansouri reste, par ailleurs, très attaché à sa région natale (Bejaâd) et celle de son père (Bzou dans le Moyen-Atlas) qu’il visite au moins une fois par an et où il supervise plusieurs actions caritatives.
Chaque année, l’homme tient plus que tout à deux rendez-vous devenus incontournables sur son agenda : la Omra à La Mecque et la commémoration, à Bejaâd, de l’anniversaire du décès de son père, Lhaj Abderrahmane Mansouri, un érudit qui a fréquenté les plus grands alems comme Mokhtar Soussi ou Ahmed Alami. En 1957, il a même été nommé grand juge de Bejaâd.
Tel Quel, novembre 2010