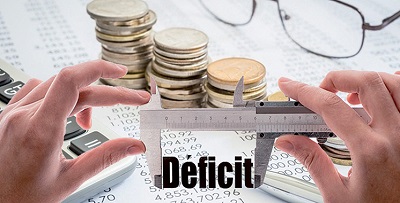Algérie, inflation, économie,
Professeur des universités, expert international, docteur d’Etat en sciences économiques -1974- Abderrahmane MEBTOUL
La rentrée sociale pour bon nombre de ménages algériens sera difficile face au processus inflationniste qui menace la cohésion sociale et donc la sécurité nationale . Analyser ce processus complexe implique, selon une vision dynamique, à la fois de le relier aux équilibres macroéconomiques et macro sociaux inséparables des mutations internes et mondiales et à la répartition du revenu entre les différentes couches sociales.
1.-L’étude du CEOWorld Magazine du mois d’août 2022, a recensé les montants du salaire net mensuel moyen (après déduction d’impôts) perçu dans 105 pays, la comparaison des données aboutissant à l’établissement de la liste des pays qui offrent les salaires les plus hauts et celles des pays qui versent les salaires les plus bas. Pour cette enquête, le salaire moyen net en Algérie s’élève en 2022 à 249,7 $/mois, soit 35 420 DA/mois (taux de change officiel, cotation du mardi 23 août 2022), données proches de celles de l’ONS. Sur les 105 pays de la liste, l’Algérie occupe la 98e place. Outre que le salaire moyen n’est pas significatif voilant les importantes disparités par couches sociales, cette enquête devrait tenir des importantes subventions octroyées en Algérie qui constituent un salaire indirect.
Au niveau mondial maintenant, les pays qui offrent les plus hauts salaires moyens nets sont : le Suisse (6142,1 $/mois), Singapour (4350,79 $/mois), l’Australie (4218,89 $/mois), les États-Unis (3721,64 $/mois) et les Émirats arabes unis. Dans le reste du top 10, on retrouve la Norvège, le Canada, le Danemark, l’Island et les Pays-Bas. Dans tous ses pays, le salaire moyen net dépasse les 3000 $. Si on se penche sur le continent africain sur les 9 pays que concerne l’étude, l’Algérie arrive en 6e position étant devancée par l’Afrique du Sud (1362 $/mois), l’Île Maurice (483,31 $/mois), le Kenya (416,53 $/mois).
Du côté du monde arabe, qui compte 14 pays, l’Algérie figure à l’avant-dernière place, devançant l’Égypte (209,7 $/mois). En tête du classement, on retrouve logiquement les pétromonarchies du Golf : les Émirats arabes unis (3663,27 $/mois), le Qatar (3168 $/mois), l’Arabie Saoudite (1888,68 $/mois), le Koweït (1854,5 $/mois) et le Bahreïn (1728,7 $/mois). Pour l’Algérie, selon les données officielles, le taux d’inflation cumulé – l’indice n’a pas été réactualisé depuis 2011 – alors que le besoin est historiquement daté (nouveaux besoins) dépasse les 100% entre 2000 et août 2022 laminant le pouvoir d’achat et posant un problème de la sécurité nationale. Car en ce mois d’août 2022 et cela a été le cas pour toute l’année 2021, le processus inflationniste a atteint un niveau intolérable : plus 100% pour les pièces détachées et les voitures d’occasion plus de 100 %, pour les produits scolaires certains articles le prix ayant triplé , certains produits alimentaires, parallèlement à une pénurie de nombre de produits, donnant un taux d’inflation moyen en glissement annuel supérieur entre août 2021 et août 2022 supérieur à 10%. Nous ne devons pas nous réjouir d’un excédent de la balance commerciale sans une relance réelle de l’économie.
Outre les factures d’électricité et d’eau, du loyer, on peut se demander comment un ménage qui gagne entre 30 000 et 50 000 DA peut survivre, s’il vit seul, en dehors de la cellule familiale qui, par le passé, grâce au revenu familial, servait de tampon social ? Mais attention à la vision populiste : octroyer des salaires sans contreparties productives entraîneraient une dérive inflationniste, qui pénaliserait les couches les plus défavorisées, l‘inflation jouant comme redistribution au profit des revenus spéculatifs et au détriment des revenus fixes ( voir notre interview Radio Algérie Internationale le 29/08/2022 sur les décisions du conseil des ministres en date du 28/08/2022).
2.-Face à cette stagnation du salaire moyen ,quelles sont les six raisons qui alimentent le processus inflationniste ? La première raison est l’inflation importée où le taux d’inflation mondial de la zone entre 2021 et août 2022 euro a atteint un niveau record obligeant les banques centrales à relever leur taux d’intérêt. La sécurité énergétique et alimentaire mondiale étant posée, les prix des produits agricoles connaissent un niveau record et, selon la FAO, où le prix des oléagineux a plus que doublé (voir notre contribution www.google.com du 13 avril 2022, face à la crise et à l’inflation mondiale: repenser la politique économique et les mécanismes de régulation sociale). La Russie et l’Ukraine représentent 30% des exportations mondiales de blé et d’orge. L’Ukraine étant le 4ème exportateur mondial de maïs. Le 5ème en blé. Le 3ème en orge. Et elle détient des positions dominantes sur le marché mondial pour le tournesol, c’est-à-dire en huile, mais également en tourteaux. particulièrement, pour l’alimentation animale avec une flambée du prix du maïs.
Ainsi, une très grave crise alimentaire se profile du fait des tensions en Ukraine où la rubrique biens alimentaires pour l’Algérie a été de plus de 8 milliards de de dollars entre 2020/2021 selon les statistiques douanières, pouvant aller en 2022, pour une importation de la même quantité physique entre 12/13 milliards de dollars sans compter les autres rubriques, épongeant les recettes d’hydrocarbures additionnelles d’hydrocarbures, ayant donc un impact sur la relance économique avec des incidences sociales. En effet, 85% des besoins des ménages et des entreprises publiques et privées – dont le taux d’intégration ne dépasse pas 15% – proviennent de l’extérieur. La deuxième raison est la faiblesse du taux de croissance interne, résultant de la faiblesse de la production et de la productivité, et les restrictions aux importations. L’Algérie, selon le rapport de l’OCDE, dépense deux fois plus pour avoir deux fois moins d’impact en référence aux pays similaires, renvoyant à la mauvaise allocation des ressources. Selon le Premier ministère, l’assainissement des entreprises publiques a coûté au Trésor public environ 250 milliards de dollars ces trente dernières années, et plus de 90% d’entre elles sont revenues à la case de départ, outre 65 milliards de dollars de réévaluation, ces dix dernières années, faute de maîtrise de la gestion des projets.
Selon le rapport du FMI publié fin décembre 2021, les exportations ont atteint, en 2021, 37,1 milliards de dollars (32,6 pour les hydrocarbures et 4,5 hors hydrocarbures) dont près de 2,5 milliards de dollars de dérivés d’hydrocarbures en prenant les estimations du bilan de Sonatrach pour 2021 (recettes de 34,5 selon le P-DG de Sonatrach) comptabilisés dans la rubrique des 4 milliards de dollars hors hydrocarbures par le ministère du Commerce. Quant aux importations, selon le FMI elles auraient atteint 46,3 milliards de dollars (la Banque mondiale ayant donné 50 milliards de dollars, provoquant d’ailleurs une polémique), 38,2 milliards de biens et une sortie de devises de 8,1 milliards de services contre 10 à 11 entre 2010 et 2019.
L’Algérie, selon le FMI, fonctionne, entre budget de fonctionnement et d’équipement, à plus de 137 dollars en 2021 et à plus de 150 pour 2022, malgré toutes les restrictions qui ont paralysé l’appareil de production avec des impacts inflationnistes, expliquant l’importance du déficit budgétaire de la loi de finances 2022 (plus de 30 milliards de dollars). La troisième raison est la dépréciation officielle du dinar qui est passée en 1970, à 4,94 dinars un dollar, en 1980 à 5,03 dinars un dollar,, en 1995 à 47,68 dinars un dollar: -2015, 100,46 dinars un dollar et 111,44 dinars un euro :: -2019 :119,36 dinars un dollar et 133,71 dinars un euro ,la cotation le 29 août 2022 selon la banque d’Algérie ( cours achat) est de 140, 24 pour un dollar et 139,30, un dinar pour un euro et pour la LF 2022 :il est prévu , 149,71 dinars un dollar en 2022 et 156 dinars en 2023. avec une cotation sur le marché parallèle, malgré la fermeture des frontières dépassant les 209 DA pour un euro la vente au cours du 29/08/2022. Cette dévaluation permet d’augmenter artificiellement la fiscalité des hydrocarbures (reconversion des exportations d’hydrocarbures en dinars) et la fiscalité ordinaire (via les importations tant en dollars qu’en euros convertis en dinar dévalué), cette dernière accentuant l’inflation des produits importés (équipements), matières premières, biens , montant accentué par la taxe douanière s’appliquant à la valeur du dinar, supportée, en fin de parcours, par le consommateur comme un impôt indirect, l’entreprise ne pouvant supporter ces mesures que si elle améliore sa productivité.
L’effet d’anticipation d’une dévaluation rampante du dinar a un effet négatif sur les sphères économique et sociale. Le taux d’intérêt des banques devrait être relevé de plusieurs points, s’ajustant aux taux d’inflation réelle, freinant à terme le taux d’investissement à valeur ajoutée si l’on veut éviter les recapitalisations répétées des banques via la rente des hydrocarbures. Pour lutter contre cette dépréciation , nous assistons à l’extensions de la sphère informelle, la déthésaurisation des ménages face à la détérioration de leur pouvoir d’achat, met des montants importants sur le marché, alimentant l’inflation, plaçant leur capital-argent dans l’immobilier, des biens durables à forte demande comme les pièces détachées facilement stockables, l’achat d’or ou de devises fortes. La quatrième raison est liée au niveau des réserves de change qui tiennent la cotation du dinar à plus de 70%.
Si les réserves de changes sont de 10 milliards de dollars, la Banque d’Algérie sera obligée de dévaluer le dinar officiel à environ 200/250 DA pour un euro avec un cours sur le marché parallèle de près de 300 DA pour un euro. Selon le rapport du FMI à fin décembre 2021, les réserves de change se sont situées à 43,6 milliards de dollars en 2021 (11 mois d’importations) contre 48,2 milliards en 2020, , 194 fin 2013 et 114 milliards de dollars en 2016. Bien que les recettes en devises prévues seraient d’environ 50 milliards de dollars fin 2022, qu’en sera-t-il avec la hausse de la facture des importations, et si on relance tous les projets nécessitant d’importantes sorties de devises et si l’investissement étranger ne vient pas ? Car tout projet nouveau n’atteindra le seuil de rentabilité (pour les PMI/PME) que dans deux à trois ans à partir de son lancement, et 6 à 7 ans pour les projets hautement capitalistiques, dans ce cas nécessitant un partenariat étranger sur la base d’un partenariat gagnant – gagnant .
La cinquième raison est l’importance du marché informel, qui sert de soupape de sécurité sociale à court terme, mais entrave le développement à moyen terme, qui représente environ 50% de la superficie de l’économie. Les prix des produits non subventionnés, s’alignent sur le cours du dinar sur le marché parallèle, amplifient l’inflation et s’étendent en période de crise. Lorsqu’un État émet des lois ou des procédures de manière autoritaire, qui ne correspondent pas à la réalité du fonctionnement de la société, celle-ci émet ses propres règles, informelles, qui lui permettent de fonctionner beaucoup plus efficacement, car reposant sur un contrat de confiance. Selon la Banque d’Algérie, entre 2019 et 2020, la masse monétaire en dehors du circuit bancaire a atteint 6 140,7 milliards de dinars, soit une hausse de 12,93% par rapport à 2019. Le président de la République a annoncé, en mars 2021, entre 6 000 et 10 000 milliards de dinars.
La sixième raison est la mauvaise gestion et la corruption à travers les surfacturations, où selon nos estimations, les entrées en devises entre 2000 et 2021 sont estimées autour de 1 100 milliards de dollars, avec des importations de biens et services pour plus de 1 050 milliards de dollars. Malgré ces dépenses en devises (sans compter les dépenses en dinars), la croissance a été dérisoire en moyenne annuelle : de 2 à 3% entre 2000 et 2019, alors qu’elle aurait dû dépasser 9/10%, à peine 3,3% pour 2021 après une croissance négative en 2020 de 4,9% .. C’est un taux faible largement inférieur à la pression démographique — plus de 45 millions d’habitants au 1er janvier 2022– où il faut pour réduire les tensions sociales, devant créer 350.000 à 400.000 emplois productifs par an qui s’ajoutent au taux de chômage selon le FMI en 2021 de 14,54 %. Au 14 juillet 2022, le nombre de bénéficiaires de demandeurs inscrits sur le site Minha Anem.Dz avoisine les 2,5 millions. parmi lesquels plus 1,8 million et demi de dossiers ont été acceptés. avec une population active de 12,5 millions cela donne un taux de chômage pour 2,5 millions des données provisoires de provisoire de 19,60%. En plus du taux de chômage, durant cette rentrée sociale, l’on ne doit pas oublier l’important déficit des caisses de retraite et une grande fraction des retraités qui connaissent des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Sur les 3,3 millions de retraités combien touchent-ils 20.000 dinars et moins par mois soit environ 150 euros/ mois au cours officiel et 100 euros au cours du marché parallèle ?
3.-Cependant évitons la sinistrose source de déstabilisations, où à court terme, contrairement aux supputations de certains qui versent toujours dans l’alarmisme, sans analyses, ni propositions réalistes, il n’y aura pas d’implosion sociale durant cette rentrée sociale 2022. Mais attention, en cas du maintien de l’actuelle politique socio-économique, les tensions sont inévitables à horizon 2022/2025. Il suffit d’aller sur le terrain loin des bureaux climatisés de nos bureaucrates, pour constater qu’il existe un sentiment d’injustice sociale et de révolte latente surtout d’une jeunesse désespérée de son avenir. D’ailleurs nous assistons au phénomène égyptien ou bon nombre de fonctionnaires en retraite ou après les heures de travail s’adonnent à d’autres emplois notamment chauffeur de taxi dénotant la détérioration de leur pouvoir d’achat. La généralisation des subventions à court terme tant qu’il y a la rente des hydrocarbures permet une paix sociale transitoire, où en 2021, le total des subventions directes et indirectes a atteint environ 5.131 milliards de DA, soit l’équivalent de 23% du PIB, les subventions généralisées s’élevant à 62% du total de ces subventions, soit près de 3.181 milliards DA (14% du PIB),processus reconduit dans la loi de finances 2022, les subventions aux produits de base représentant pour 2022 un total de 17 milliards de dollars. Cela concerne les carburants, l’électricité, l’eau , les aides au logement, à l’emploi et les principaux produits de première nécessité. En revanche, à terme il s’agira de cibler les subventions qui généralisées sont insoutenables pour le budget, ces subventions ayant permis aux ménages algériens de réaliser une épargne. C
ependant, il suffit de visiter les endroits officiels de vente de bijoux pour voir qu’il y a « déthésaurisation » et que cette épargne est, malheureusement, en train d’être dépensée, des ménages sur le fil du rasoir pouvant tenir encore au maximum deux ans et seul un retour à la croissance permettra d’améliorer le pouvoir d’achat des Algériens.
Aussi, reconnaissons qu’avec la rentrée sociale 2022, la marge du gouvernement est étroite. Cela n’étant pas propre à l’Algérie où le taux d’inflation mondial atteint un niveau record , 8,9% au sein de la zone euro en juillet 2022, 6,1% en France, 8,8% en Allemagne, 9% en Italie, 10% en Espagne, 25,2% en Estonie, 21,1% en Lituanie , 20,8% en Lettonie, près de 80% en Turquie et pour les USA, en juin, à 9,1% en rythme annuel, un record depuis 41 ans obligeant les banques centrales à relever leur taux d’intérêt. Face à ce processus inflationniste accentué par les tensions géostratégisues, avec un impact sur le pouvoir d’achat, tous les gouvernements de par le monde,se trouvent face à la résolution d’une équation complexe : soit augmenter les salaires via la planche à billets ( financement non conventionnel) la théorie néo keynésienne de relance de la demande globale à travers l’émission monétaire, résolvant un problème à court terme mais amplifiant la crise à moyen terme, étant inappropriée pour l’Algérie qui souffre de rigidités structurelles (léthargie de l’appareil de production) accentuant la spirale inflationniste incontrôlable ou pas augmenter les salaires avec le risque de l’intensification des revendications sociales. La population face aux nombreux scandales financiers exige un sacrifice partagé.
La structure des sociétés modernes s’est bâtie d’abord sur des valeurs et une morale qui a permis la création de richesses permanentes, comme nous l’ont enseigné les grands penseurs dont le grand sociologue Ibn Khaldoun qui, dans son cycle des civilisations, montre clairement que lorsque l’immoralité atteint les dirigeants qui gouvernent la Cité c’est la décadence de toute société. Il s’agit de rétablir la confiance et la morale sans lesquelles aucun développement n’est possible.. C’est alors seulement que les algériens vivront leurs différences, accepteront le dialogue productif, auront envie de construire ensemble leur pays et d’y vivre dignement. Et alors malgré les tensions internes et géostratégiques dans la région méditerranéenne et sahélienne et budgétaires , l’Algérie pays pivot , du fait de ses importantes potentialités pourra surmonter la crise actuelle qui est une crise mondiale.
#Algérie #Inflation #Economie