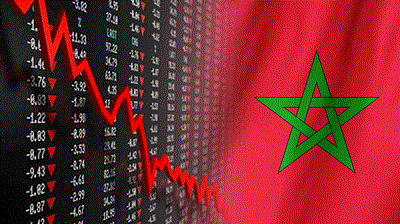Algérie, économie, enjeux énergétiques et géostratégiques, crise ukrainienne,
Situation de l’économie algérienne 2020/2021 et perspectives 2022/2025 face aux enjeux énergétiques et géostratégiques
L’Algérie dans la crise ukrainienne a adopté une position de neutralité, position réaffirmée par le président de la république et le chef de l’Etat- major de l’ANP ayant des relations avec les USA, l’Europe, la Russie et la Chine, prônant le dialogue et le respect du droit international .C’est que La crise ukrainienne préfigure d’importantes mutations dans les relations internationales, militaires, sécuritaires, politiques, culturelles et économiques,, notamment au niveau de la région méditerranéenne et africaine, où la crise actuelle a des impacts sur le cours du pétrole/gaz, plus de 40% de dépendance de la Russie pour l’Europe, mais également sur la sécurité alimentaire dont la Russie et l’Ukraine représentent en 2021 30% des exportations mondiales. Pour se libérer progressivement de l’importation du gaz russe , pour le pétrole possible mis difficile court terme pour le gaz, certains pays dont la dépendance dépasse les 60%, l’Algérie est sollicitée à la fois contre le terrorisme et pour couvrir le déficit énergétique. ( (voir professeur A. Mebtoul magazine mensuel El moudjahid de juin 2022 et interview au quotidien le Monde.fr Paris samedi 04/06/2022 sur les enjeux énergétiques et géostratégiques face à la crise ukrainienne).
1.-Quelle est la situation socio-économique? Les principales dispositions de la loi de finances 2022, indicateurs dont bon nombre d’indicateurs devront être révisés la lumière de la nouvelle conjoncture mondiale se basent sur un cours du pétrole de 45 dollars le baril et un prix du marché de 50 dollars et prévoient une croissance de 3,3% contre 3,4% en 2021 et moins 6% en 2020. Un taux de croissance faible donne une croissance faible. Il faut être réaliste. Si les projets du fer de Gara Djebilet et du phosphate de Tébessa commencent leur production en 2022, l’investissement de ces deux projets étant estimées à environ 15 milliards de dollars, le seuil de rentabilité ne sera atteint que dans 6/7 ans et, pour les PMI/PME, dans deux à trois ans. Selon le FMI dans son rapport de décembre 2021, les importations en 2021 ont atteint 46,3 milliards de dollars (la Banque mondiale ayant donné 50 milliards de dollars), 38,2 milliards de biens et une sortie de devises de services de 8,1 milliards et des exportations de 37,1 milliards de dollars.
Malgré le dérapage de la monnaie nationale — pour ne pas dire dévaluation – de 5 dinars vers les années 1970/1973, de 80 dollars entre 2000/2004 et le 02 juin 2022, cours achat 145,6139 dinars un dollar et 155, 5156 dinars un euro avec un cours sur le marché parallèle de 214 dinars un euro et 200 dinars un dollar., les prix de biens non subventionnés s’alignent souvent sur le marché parallèle, qui combiné avec l’inflation mondiale accélérant l’inflation qui selon les sources officielles entre 2000/2021 dépasse les 100% , s’étant accélérée durant les mois de 2022, laminant le pouvoir d’achat.
Contrairement aux théories classiques, cela n’a pas permis de dynamiser les exportations hors hydrocarbures qui engendrent 97 à 98% (avec les dérivés) des entrées en devises.. Ainsi, entre 2000 et 2021, l’Algérie a engrangé plus de 1100 milliards de dollars avec une importation de biens et services en devises dépassant 1050 milliards de dollars ( le solde étant les réserves de change 31/12/2021) pour un taux de croissance dérisoire de 2 à 3% en moyenne annuelle alors que ce taux aurait dû être de 8/9% mauvaises gestion ou corruption ou les deux la fois.
Le déficit budgétaire pour 2022, dépasse selon la loi de finances 2022, 30 milliards de dollars accélérant le processus inflationniste dont l’indice n’a pas été réactualisé depuis 2011. Entre 2020 et 2021 certains produits (comme les pièces détachées en pénurie croissante), l’inflation pour les produits non subventionnés a connu une hausse de 50 à 100%. Du fait que plus de 85% des matières premières sont importées, le taux d’intégration est faible, par les entreprises publiques et privées, sans compter l’assistance technique étrangère, avec la dévaluation du dinar entre 2022 et 2024, l’inflation sera de longue durée.
Selon les prévisions de l’Exécutif, le taux de change du dinar sera de 149,3 DA pour un dollar en 2021 de 156,8 DA/dollar en 2023 et 164,6 DA/dollar en 2024. Ce dérapage du dinar permettra d’atténuer ce déficit budgétaire car si on avait un dollar – 100 dinars, il faudrait pondérer à la hausse d’au moins 37% le déficit budgétaire qui serait, à fin 2022, supérieur à 42 milliards de dollars.
L’Algérie, selon le FMI, fonctionnant entre le budget de fonctionnement et d’équipement à plus de 137 dollars en 2021 et à plus de 150 pour 2022. Aussi, malgré toutes les restrictions qui ont paralysé l’appareil de production, les réserves de change sont en baisse continue, passant de 194 milliards de dollars au 1er janvier 2014 à 62 fin 2019, à 48 fin 2020 et à 44 milliards de dollars fin 2021.
La faiblesse du taux de croissance se répercute sur le taux d’emploi avec la pression démographique, 45 millions d’habitants au 01 janvier 2022, devant créer entre 350.000/400.000 emplois nouveaux par an, où .en plus du licenciement, uniquement dans le BTPH, de 150 000 emplois en 2021, influe sur le taux de chômage qui, selon le FMI, en 2021 serait de 14,1% , incluant les sureffectifs des administrations, entreprises publiques et l’emploi dans la sphère informelle, représentant plus de 40% concentré dans les services et les segment à faible valeur ajoutée. Pour éviter des remous sociaux, tous les gouvernements ont généralisé les subventions, source de gaspillage croissant des ressources financières du pays.
Pour les prévisions 2022, les subventions implicites, constituées notamment de subventions aux produits énergétiques et de subventions de nature fiscale, représentent environ 80% du total des subventions. Les subventions explicites représentent un cinquième du total des subventions, étant dominées par le soutien aux prix des produits alimentaires et au logement, prévoyant 1 942 milliards de dinars et, au cours de 137 DA pour un dollar, au moment de l’élaboration de la loi de finance 2022, 14,17 milliards de dollars, soit 19,7% du budget de l’Etat.
Un dossier très complexe que le gouvernement a décidé de revoir, mais sans maîtrise du système d’information et de quantification de la sphère informelle, qui représente plus de 50% de la superficie économique hors hydrocarbures produit de la bureaucratie favorisant les délits d’initié (corruption) dont l’extension décourage tout investisseur, ce qui permet la consolidation de revenus non déclarés, la réforme allant vers des subventions ciblées risque d’avoir des effets pervers. Cependant, pour 2022, l’Algérie profite d’un répit temporaire alors que les prix des hydrocarbures atteignent de nouveaux sommets et que la pression de la pandémie de COVID-19 se relâche.
Se basant sur un cours variant entre 100/110 dollars le baril de pétrole et un prix du gaz naturel , existant une différence d’environ 15 20% entre les exportations du gaz par canalisation et le GNL plus coûteux, qui a dépassé en Europe 20 dollars le MBTU et 30 dollars en Asie , le Fonds monétaire international (FMI) dans une note d’ avril 2022,les recettes pour l’Arabie saoudite pourraient être de 327 milliards de dollars comme recettes en 2022. suivie par les Emirats Arabes Unis avec 190 milliards de dollars, l’Irak 149 milliards de dollars, le Koweït, avec 102 milliards de dollars, le Qatar 84 milliards de dollars.
Les recettes prévues pour l’Algérie seraient de 58 milliards de dollars.pour 2022, possédant des marges de manœuvre à court terme, l’endettement extérieur étant faible, le stock de la dette extérieure de l’Algérie à fin 2020 ayant atteint 5,178 milliards de dollars contre 5,492 milliards de dollars en 2019, selon le rapport “International Debt Statistics 2022 de la Banque mondiale. C’est pourquoi , le gouvernement actuel a décidé de ne pas recourir à l’endettement extérieur pour financer le déficit,la banque centrale étant sollicitée pour le financement monétaire. Certes, l’économie algérienne a renoué avec la croissance en 2021, tiré par la hausse des prix de l’énergie et l’augmentation des quotas de production de l’OPEP +,mais la croissance entre 2022/2023 sera largement dépendante du marché des hydrocarbures.
Cette situation est éphémère sans réformes structurelles souvent différées qui exacerbent les facteurs de vulnérabilité économique où la dette publique représente 50.7% du PIB en 2020 et selon les projections du FMI 59.2% du PIB en 2021 et 65.4% en 2022. En prenant les indicateurs de la banque mondiale importation et exportations pour 2021, selon la banque mondiale 46 milliards de dollars d’importations et 37 milliards de dollars d’exportation contre 20 en 2020 du fait de l’inflation mondiale, les importations seulement des ,biens alimentaires ayant été d’environ 9 milliards de dollars en 2021, posant un problème de la sécurité alimentaire, si on pondère seulement par 50%,pour avoir la même structure d’importation que 2021, ne comptabilisant les nouveaux investissements importés en devises, il faudrait plus de 60 milliards de dollars de recettes en devises et tenant compte des projets d’investissement prévus, pour relancer la machine économique plus de 70 milliards de dollars. Cela nécessite un apport important d’IDE qui ont fortement baissé entre 2018/2021 où d’après les données publiées par la CNUCED dans le Rapport sur l’investissement mondial 2021, les IDE en Algérie ont diminué de 19 % pour atteindre 1,1 milliard USD en 2020 (contre 1,3 milliard USD en 2019), un code d’investissement étant une condition nécessaire mais non suffisante devant s’attaquer avant tout à l’essence du blocage l’écosystème par une nouvelle gouvernance.
2.- Face à la crise ukrainienne et notamment al crise énergétique , quelle place pour l’Algérie, l’Algérie est sollicitée à la fois contre le terrorisme et pour couvrir le déficit énergétique. Nous avons assisté à une baisse substantielle des exportations d’hydrocarbures à ne pas confondre avec la production qui est la sommation de la consommation intérieure, d’un pourcentage de réinjection dans les puits et des exportations. Pour le pétrole les exportations avoisinent 500.000 barils/j contre plus de 1,2 en 2005/2007 et pour le gaz 43 milliards de mètres cubes gazeux contre plus de 65 pour la même période du fait d’un désinvestissement et de la forte consommation intérieure.
Sans compter la part du GNL représentant 33% des exportations, pour les canalisations nous avons le Transmed via l’Italie, la plus grande canalisation d’une capacité de 33,5 milliards de mètres cubes gazeux via la Tunisie, avec en 2021 une exportation d’environ de 21/22 milliards de mètres cubes gazeux, existant une possibilité, au maximum, il ne faut pas être utopique ayant assisté à un désinvestissement dans le secteur, donc sous réserve de l’accroissement de la production interne d’un supplément à court terme, au maximum de trois à quatre milliards de mètres cubes gazeux.
Nous avons le Medgaz directement vers l’Espagne à partir de Beni Saf au départ d’une capacité de 8 milliards de mètres cubes gazeux qui après extension depuis février 2022 la capacité ayant été portée à 10 milliards de mètres cubes gazeux et le GME via le Maroc dont l’Algérie a décidé d’abandonner, le contrat s’étant achevé le 31 octobre 2022, d’une capacité de 13,5 de milliards de mètres cubes gazeux. Mais, il faut être réaliste, Sonatrach est confrontée à plusieurs contraintes : des contrats de gaz fixes à moyen et long terme dont la révision des clauses demande du temps ; le désinvestissement dans le secteur et surtout la forte consommation intérieure, presque l’équivalent des exportations pétrole et gaz en 2021, qui risque horizon 2025/2030 selon les rapports du Ministère de l’Energie, de dépasser les exportations actuelles, dossier lié à la politique des subventions sans ciblage, dossier sensible qui demande un système d’information en temps réel et la maîtrise de la sphère informelle qui contrôle, selon les propos du président de la République entre 6000/10.000 milliards de dinars, soit entre 33 et 47% du PIB.
Sous réserve de sept conditions, l’Algérie horizon 2025/2027, pourrait pouvant doubler les capacités d’exportations de gaz environ 80 milliards de mètres cubes gazeux avec une part dépassant entre 20/25% de l’approvisionnement de l’Europe : La première condition concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique et une nouvelle politique des prix renvoyant au dossier de subventions La deuxième condition est relative à l’investissement à l’amont pour de nouvelles découvertes d’hydrocarbures traditionnels, tant en Algérie que dans d’autres contrées du monde, mais pouvant découvrir des gisements non rentables financièrement; La troisième condition, est liée au développement des énergies renouvelables (actuellement dérisoire moins de 1% de la consommation globale) devant combiner le thermique et le photovoltaïque le coût de production mondial a diminué de plus de 50% et il le sera plus à l’avenir où, avec plus de 3000 heures d’ensoleillement par an, l’Algérie a tout ce qu’il faut pour développer l’utilisation de l’énergie solaire.
La quatrième condition, selon la déclaration de plusieurs ministres de l’Énergie entre 2013/2020, l’Algérie compte construire sa première centrale nucléaire en 2025 à des fins pacifiques, pour faire face à une demande d’électricité galopante La cinquième condition, est le développement du pétrole/gaz de schiste, selon les études américaines, l’Algérie possédant le troisième réservoir mondial, d’environ 19 500 milliards de mètres cubes gazeux, mais qui nécessite, outre un consensus social interne, de lourds investissements, la maîtrise des nouvelles technologies qui protègent l’environnement et des partenariats avec des firmes de renom.
La sixième condition, consiste en la redynamisation du projet GALSI, Gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie, qui devait être mis en service en 2012 d’une capacité de 8 milliards de mètres cubes gazeux La septième condition est l’accélération de la réalisation du gazoduc Nigeria-Europe via l’Algérie d’une capacité de plus de 33 milliards de mètres cubes gazeux. Cependant, l’avenir appartenant à l’hydrogène comme énergie du futur 2030/2040 ( voir Mebtoul le monde .fr 04/06/2022)
3.- Quelles perspectives et actions à mener ? Le dépassement de l’entropie actuelle et les tensions géostratégiques aux frontières de l’Algérie posent la problématique de la sécurité régionale dont l’Algérie étant considérée par l’Europe, les USA, la Russie et la Chine pour ne parler que des principaux acteurs mondiaux,un pays stratégique pour la stabilité de la région méditerranéenne et africaine, passant par la relance de son économie.
En 2022 afin de réaliser la transition énergétique et numérique, il faut une stratégie articulée autour d’une autre organisation institutionnelle, : un grand ministère de l’Energie avec trois secrétaires d’Etat techniques : les énergies traditionnelles, les énergies renouvelables et l’environnement étant irrationnel l’existence de trois ministères. Et cela concerne d’autres organisations, notamment devant regrouper l’industrie, les PME/PME, les mines et les startup et un grand ministère de l’Economie regroupant le commerce et les finances et, au niveau local, six à sept grands pôles économiques régionaux autour d’espaces relativement homogènes pour attirer les investisseurs créateurs de valeur ajoutée. Le développement devra résulter d’une réelle volonté politique allant vers de profondes réformes, une libéralisation maîtrisée, un rôle stratégique de l’État régulateur conciliant efficacité économique et justice sociale, évitant l’idéologie populiste dévastatrice, de versements de salaires sans contreparties productives, une Nation ne pouvant distribuer que ce qu’elle a préalablement produite.
Le frein à la mise en œuvre d’affaires saines est le terrorisme bureaucratique qui enfante la sphère informelle et la corruption. La réforme de l’administration et du système financier, cœur des réformes, est essentiel pour attirer l’investisseur avec la marginalisation du secteur privé, puisque les banques publiques continuent à accaparer 90% des crédits octroyés étant carrément saignées par les entreprises publiques avec un assainissement qui a coûté au Trésor public, selon des données récentes (2021) du Premier ministère, ces trente dernières années environ 250 milliards de dollars, sans compter les réévaluations répétées ces dix dernières années de plus de 65 milliards de dollars, entraînant des recapitalisations répétées des banques, malades de leurs clients.
Enfin comme frein à l’investissement l’absence d’un marché foncier où la majorité des wilayas livrent des terrains à des prix exorbitants, souvent sans commodités (routes, téléphone, électricité/gaz, assainissement) et l’inadaptation du marché du travail à la demande, renvoyant à la réforme du système éducatif et de la formation professionnelle, évitant des usines fabricant de futurs chômeurs.
En conclusion, la crise ukrainienne préfigure d’importantes mutations dans les relations internationales, militaires, sécuritaires, politiques, culturelles et économiques,, notamment au niveau de la région méditerranéenne et africaine, où la crise actuelle a des impacts sur le cours du pétrole/gaz, plus de 40% de dépendance de la Russie pour l’Europe, mais également sur la sécurité alimentaire dont la Russie et l’Ukraine représentent en 2021 30% des exportations mondiales. Pour se libérer progressivement de l’importation du gaz russe, pour le pétrole possible mais difficile court terme pour le gaz, certains pays dont la dépendance dépasse les 60%. D’une manière générale entre 2022/2030, et cela s’accentuer entre 2030/2040, les nouvelles mutations mondiales affectent les recompositions politiques à l’intérieur des États comme à l’échelle des espaces régionaux
Professeur des universités, expert international docteur d’Etat 1974- Abderrahmane MEBTOUL (ademmebtoul@gmail.com)
#Algérie #Economie #Enjeux #Crise_ukrainienne