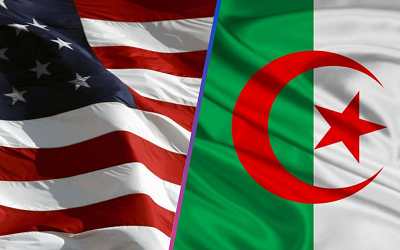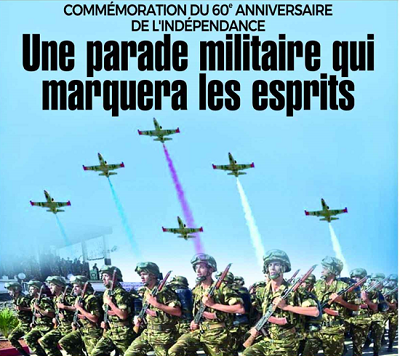Algérie, Etats-Unis, Russie, Espagne, Europe, Gaz, énergie, Pétrole, Chine,
par Vasilis Petropoulos
La guerre en cours en Ukraine, avec sa recristallisation des allégeances, peut fournir à l’Algérie l’occasion de revenir d’un virage vers la Russie et la Chine à une relation plus équilibrée avec les grandes puissances.
ÉTATS-UNIS : Du partenariat stratégique à l’insignifiance
À bien des égards, les relations étrangères les plus directes de l’Algérie avec les États-Unis et les pays d’Europe occidentale sont carrément axées sur ses voisins du nord, l’Espagne et la France. Pourtant, en tant que superpuissance inégalée de ces trois dernières décennies, les États-Unis ont eu un certain type d’impact sur les décisions de politique étrangère de presque tous les pays. Les investissements étrangers directs, l’aide militaire et l’accès à la technologie américaine ne sont que quelques-uns des outils utilisés par Washington pour séduire ses partenaires et façonner leurs politiques à l’étranger. Dans de nombreux cas, l’obtention de ces « cadeaux » est devenue le moteur de la politique étrangère de nombreux pays, faisant progressivement grandir le camp « pro-américain ».
L’Algérie, bien qu’elle n’ait jamais été clairement « pro-américaine » ou officiellement alignée sur l’Occident, n’échappe pas à cette règle. Après avoir épousé une « neutralité subjective » à l’époque de la guerre froide – penchant pour le bloc communiste tout en restant dans le mouvement de non-alignement – l’Algérie a suivi la vague du monde unipolaire post-soviétique et a approfondi ses liens avec l’Occident.
Cette décision s’explique moins par un changement idéologique que par les opportunités économiques dont elle avait grand besoin dans les années qui ont suivi la guerre civile algérienne (1991-2002). Capitalisant sur sa position géostratégique, son cachet régional en tant qu’exemple de lutte révolutionnaire contre la domination coloniale, et ses capacités militaires considérables, l’Algérie a ensuite démontré sa valeur géostratégique à Washington. Alger a joué un rôle important en fournissant des renseignements et en participant aux opérations antiterroristes visant Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et, plus tard, ISIS, jouant ainsi un rôle central dans la « guerre contre le terrorisme ».
En retour, Alger a reçu de grandes quantités d’aide financière et de formation de la part de son partenaire transatlantique et la relation entre les États-Unis et l’Algérie semblait être sur la pente ascendante. Au lieu de cela, la neutralisation de la menace de Daesh en 2017, couplée à l’arrivée de Trump au pouvoir et à l’approche » America First » de son administration axée sur les partenaires et rivaux historiques a constitué une conjoncture défavorable pour l’Algérie.
La relation s’est clairement dégradée lorsque Trump a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental face aux revendications du Front Polisario, allié stratégique de l’Algérie pour contrôler le Maroc. En retour, le Maroc a adhéré aux Accords d’Abraham, reconnaissant ainsi Israël, l’allié crucial de Washington au Moyen-Orient. Les décisions américaines et marocaines ont frappé au cœur des préoccupations d’Alger en matière de sécurité nationale et de politique étrangère. L’agitation intérieure concomitante du mouvement Hirak en 2019 n’a pas laissé beaucoup d’espace pour les priorités de politique étrangère, laissant le nouveau gouvernement avec peu de capital politique pour donner une réponse concrète à cet échec diplomatique massif selon les normes d’Alger.
Contrairement aux attentes algériennes selon lesquelles l’administration Biden changerait de cap, aucun revirement de cette décision n’a émergé, et les relations aigres entre Washington et Alger ne se sont pas améliorées depuis 2020. En fait, il n’est pas exagéré de dire qu’elles sont actuellement à leur point le plus bas. Ce nadir, conjugué à la récente brouille avec la France et à la rupture simultanée avec l’Espagne au sujet du passé colonial de la première et de la nouvelle approche de la seconde sur la question du Sahara occidental, a conduit Alger à un isolement sans précédent du monde occidental. En retour, cet isolement a conduit l’Algérie à renforcer ses liens avec les puissances révisionnistes et à dévaloriser ceux avec l’Occident, comme en témoignent l’attitude punitive et l’intransigeance croissante d’Alger envers la France et l’Espagne.
La Russie et la Chine : Les bras ouverts
Au cours des deux dernières années, l’alliance informelle de la Russie et de la Chine s’est avérée heureuse de rapprocher l’Algérie en réponse, offrant à l’Algérie un ticket pour la « désisolation ». Ces liens remontent à plusieurs décennies ; Alger et Moscou ont partagé un lien fort depuis l’indépendance de la première et ont construit un partenariat étroit. Dans le cadre d’un protocole d’accord signé en 2006, la société russe Gazprom a également aidé la société publique algérienne Sonatrach à développer sa production de GNL.
Les relations en matière de sécurité sont particulièrement étroites ; l’Algérie est tributaire des importations d’armes russes, puisqu’elle a acheté 81 % de ses équipements militaires à la Russie au cours des trois dernières années et qu’elle est le troisième importateur d’armes de la Russie, après l’Inde et la Chine. Au cours des années 2010, les exportations d’armes russes ont augmenté de 129 % par rapport à la décennie précédente. En 2022, l’Algérie est le troisième client d’armes de la Russie, juste derrière l’Inde et la Chine. L’Algérie et la Russie ont mené des exercices militaires conjoints dans des zones contestées, comme l’Ossétie du Sud en octobre 2021, et ont convenu d’effectuer une activité similaire sur les frontières algériennes avec le Maroc en novembre 2022 – un accord conclu lors de l’invasion russe de l’Ukraine.
Non seulement Alger a acquiescé à cet exercice militaire lors de l’invasion russe de l’Ukraine, mais ses diplomates ont également refusé de condamner Moscou à l’ONU en mars, malgré l’adhésion historique de l’Algérie au principe de la souveraineté des États. En échange, la Russie soutient l’Algérie dans la question du Sahara occidental – ce qui est compris comme un moyen de contrer l’alliance du Maroc avec les États-Unis – et elle a annulé des milliards de dollars de dette algérienne.
À l’instar des liens russo-algériens, les relations chaleureuses avec la Chine remontent à l’époque de la guerre froide, et plus particulièrement à la période Mao Zedong. Récemment, les ambitions mondiales de Pékin, renforcées par son gigantesque projet d’initiative « la Ceinture et la Route » (Belt and Road Initiative, BRI), ont amené la Chine aux portes de divers pays du monde avec des propositions de partenariat et d’investissement. L’Afrique du Nord a été incluse dans la portée mondiale de la Chine et l’Algérie est disposée à étendre davantage l’empreinte de Pékin en tant que partenaire régional le plus précieux de cette dernière.
La Chine a déjà fortement investi dans les infrastructures en Algérie et les flux commerciaux entre les deux vieux amis sont montés en flèche au cours de la dernière décennie. Les entreprises chinoises des secteurs de l’énergie et de la construction se multiplient sur le sol algérien, tandis qu’Alger est partie prenante du projet BRI. Dans le cadre de ce projet en Algérie, Pékin et Alger ont convenu d’un projet de 3,3 milliards de dollars pour la construction du premier port en eau profonde en Algérie dans la ville côtière de Cherchell, à l’ouest de la capitale algérienne. Le port d’El Hamdania sera le deuxième plus grand port en eau profonde d’Afrique. Enfin, mais c’est important, la Chine devient progressivement un important exportateur d’armes vers l’Algérie. Depuis 2018, l’Algérie a reçu ou commandé une vingtaine de drones de reconnaissance et de combat chinois de classes assorties. En 2018 par exemple, cinq drones Rainbow CH-3 et cinq Rainbow CH-4 ont été livrés à l’Algérie et pas plus tard qu’en janvier 2022, cette dernière a commandé six drones chinois Rainbow CH-5 qui constituent la version la plus avancée de la série.
En résumé, l’intérêt de l’Algérie pour ses relations avec la Chine et la Russie ne sont pas des faits nouveaux. Cependant, la perception par l’Algérie du fait que Washington soutient ouvertement et continuellement le Maroc au détriment de lui-même pousse l’Algérie à se rapprocher de la Russie et de la Chine et à distendre ses anciens liens avec l’autre camp. Les deux États sont heureux d’exploiter la déception et le sentiment d’isolement d’Alger. En puisant dans les anciens liens de la guerre froide, ils se sont montrés désireux de rompre la politique d’équilibre de l’Algérie entre eux et l’Occident et de faire entrer fermement Alger dans le camp révisionniste. Cette stratégie semble avoir porté ses fruits jusqu’à présent : L’Algérie s’affirme davantage dans ses relations avec l’Occident, comme le montre la crise diplomatique actuelle avec l’Espagne.
Rééquilibrage : Opportunités et défis
Alors que l’Algérie tente d’endiguer l’instabilité intérieure et de naviguer dans un paysage géopolitique en mutation, il existe des opportunités et des défis diplomatiques qu’elle devrait prendre en considération avant d’être aspirée par l’inertie dans ce camp révisionniste.
Pour commencer, l’invasion russe en Ukraine a peut-être déclenché de nombreux effets d’entraînement au niveau mondial, tels que l’insécurité alimentaire, mais elle a également créé des opportunités pour Alger qui pourraient l’aider à faire face au « défi de l’isolement » auquel elle a été confrontée avec les États occidentaux ces dernières années.
Au lendemain de l’invasion, l’Occident a fait preuve de plus d’unité qu’à tout autre moment après l’effondrement de l’Union soviétique. La réponse à l’acte d’agression de Poutine a été si uniforme et si radicale que les pays occidentaux ont semblé se rallier autour d’un objectif commun : sauvegarder l’ordre international libéral de l’après-guerre froide contre le révisionnisme affirmé de la Russie. Cependant, d’autres acteurs tels que la Chine et l’Iran ont adhéré à ce révisionnisme et soutiennent la Russie, de manière explicite ou implicite.
Dans son effort pour contrer ce bloc révisionniste, l’Occident a besoin de tous les alliés possibles et l’Algérie peut utiliser cette carte pour gagner sur les deux tableaux. L’Algérie a l’opportunité de redevenir pertinente aux yeux des États-Unis tout en gardant les canaux de communication ouverts avec la Russie, la Chine et l’Iran, en même temps. En d’autres termes, l’Algérie peut adopter une politique étrangère semblable à celle employée avec succès par l’Inde, c’est-à-dire une politique sans entrave et non alignée.
En outre, la guerre en Ukraine offre à l’Algérie de nombreuses opportunités liées à l’énergie. La flambée des prix du pétrole et du gaz a contribué à générer des rentes élevées pour l’économie algérienne dépendante de l’énergie, qui a souffert de la chute des prix du pétrole pendant la pandémie de Covid-19. L’Europe a clairement indiqué qu’elle entendait remplacer les importations de pétrole et de gaz russes par des importations de GNL (gaz naturel liquéfié) et de pétrole brut provenant d’autres partenaires, avec de nombreux projets de terminaux GNL à l’horizon.
L’Algérie, exportateur d’énergie de longue date vers l’Europe du Sud, a donc la possibilité d’augmenter considérablement ses ventes à l’ensemble du continent. Ce faisant, Alger bénéficiera d’un avantage à la fois économique et diplomatique, puisqu’elle acquerra une importance renouvelée dans l’agenda de Washington en tant que partenaire crucial de la quête d’indépendance énergétique de l’Europe, une priorité de longue date pour les États-Unis. En fait, l’Algérie a déjà exploité cette nouvelle dynamique en signant un accord énergétique gigantesque avec l’Italie en avril 2022. Cet accord fera de l’Algérie le premier fournisseur de gaz de l’Italie, supplantant ainsi la Russie qui occupait cette position depuis de nombreuses années.
Outre le problème de son isolement en Méditerranée, Alger doit rétablir ses liens avec la France et l’Espagne au profit de la fragile économie du pays. Il lui faut de toute urgence accéder aux grands marchés européens pour profiter de la flambée des prix de l’énergie et exploiter les aspirations de l’Occident à mettre fin au quasi-monopole de la Russie sur les exportations d’énergie vers l’Europe. Ce dernier point ramènera également l’attention de Washington sur la région. La ligne est mince : l’Algérie doit également s’attaquer à la dépendance excessive de son économie vis-à-vis du secteur pétrolier et à la précarité économique qui en découle. Comme d’autres victimes du « syndrome hollandais », les exportations deviennent plus chères et les importations moins chères, ce qui entraîne le déclin d’autres secteurs cruciaux de l’économie.
Le défi de l’Algérie dans la gestion de ses exportations énergétiques est également lié à la demande intérieure galopante en énergie. Les conditions sont idéales pour qu’Alger se lance dans un rallye des exportations d’énergie afin de se remettre complètement de la régression économique déclenchée par Covid-19, mais elle doit le faire sans négliger l’augmentation considérable de la population du pays chaque année, qui se traduira par une demande énergétique croissante au niveau national.
Néanmoins, une remise à zéro avec les voisins du nord d’Alger s’impose. Pour qu’un tel rapprochement avec la France et l’Espagne ait lieu, l’Algérie devrait tempérer le discours nationaliste qui imprègne sa politique étrangère par du pragmatisme et mettre l’accent sur les avantages qu’elle peut tirer de la conclusion d’accords commerciaux plus solides avec ses partenaires énergétiques européens. Le dégel des relations franco-espagnoles-algériennes ne peut pas non plus être un effort unilatéral. De leur côté, Madrid et Paris devraient également apaiser Alger en s’abstenant de soulever des questions controversées et sensibles, à l’encontre de ce dernier, et en ne prenant pas publiquement parti pour le Maroc sur la question du Sahara occidental.
Dans le cas de la France, les Champs Elysées semblent comprendre cela et semblent prêts à prendre des mesures pour apaiser les tensions. Le récent appel du président Macron à son homologue algérien démontre la volonté française de rapprochement. À l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance algérienne, le dirigeant français a envoyé une lettre au président Tebboune appelant au « renforcement des liens franco-algériens déjà forts ».
L’Algérie traverse peut-être la période la plus critique de son histoire diplomatique depuis la fin de la guerre civile dans les années 1990. Des défis pressants d’un côté et des opportunités prometteuses de l’autre constituent l’environnement géopolitique actuel. L’Algérie doit le reconnaître, et alors que la guerre en Ukraine continue de remodeler les relations multilatérales au sens large, Alger doit déterminer si elle maintient sa neutralité ou dérive davantage vers le camp révisionniste – une décision qui affectera sa position dans les systèmes régionaux et internationaux.
Washington Institute for Near East Policy, 09/08/2022
#Algérie #Etats_Unis #Russie #Chine #Espagne #Europe #Gaz #Pétrole