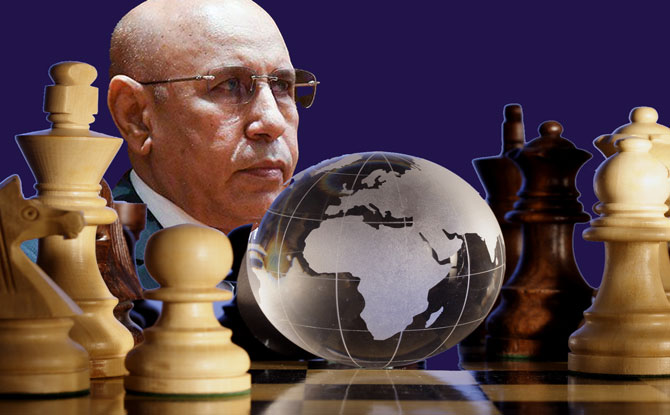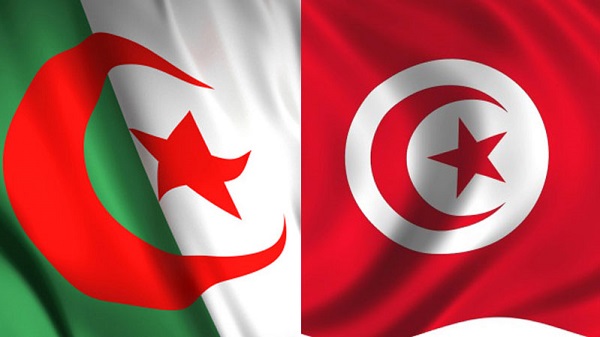Le conflit du Sahara occidental, le Maroc et l’Algérie – Front Polisario, Maghreb, Union Européenne, UE, Russie, Israël, migration,
Comment le conflit du Sahara occidental alimente de nouvelles tensions entre le Maroc et l’Algérie.
Résumé
-Les tensions entre le Maroc et l’Algérie ont augmenté ces derniers temps, et le risque de conflit armé est désormais plus élevé.
-Cette escalade trouve son origine dans le conflit sur le statut du Sahara occidental, où le Maroc semble estimer que sa revendication de souveraineté bénéficie d’un soutien international.
-Le Maroc et l’Algérie entretiennent des relations importantes avec Israël et la Russie respectivement, mais ils ont également en commun des partenaires importants qui pourraient jouer un rôle dans la prévention de l’aggravation de l’impasse.
-Le Maroc et l’Algérie ont des intérêts en Europe que l’UE et les États membres peuvent utiliser pour minimiser les tensions, et réduire le risque d’instabilité et d’augmentation des flux migratoires à travers la Méditerranée.
-Pour y parvenir, les Européens devraient établir une relation plus équilibrée avec le Maroc, sans aliéner l’Algérie, tout en cherchant à consolider leur engagement avec l’Algérie.
Introduction
Le Maroc et l’Algérie, les pays dominants du Maghreb, sont enfermés dans une impasse diplomatique. Leur rivalité remonte à plusieurs décennies, mais elle a pris une tournure dramatique au cours de l’année dernière. Depuis août 2021, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, coupé les livraisons de gaz qui passaient auparavant par le Maroc pour atteindre l’Espagne, et accusé les forces marocaines d’avoir tué trois citoyens algériens dans le territoire contesté du Sahara occidental. Les tensions entre ces deux pays lourdement armés ont suscité des inquiétudes dans la région et en Europe, qui craignent que le Maroc et l’Algérie ne dérivent vers un conflit ouvert, risquant de déstabiliser massivement l’Afrique du Nord avec toutes les conséquences que cela impliquerait pour l’Union européenne.spa
L’escalade est intervenue après que les relations déjà médiocres entre les deux pays ont été perturbées par une série de développements, notamment un changement de position des puissances extérieures. Un moment décisif a été la décision du président Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en décembre 2020 en échange de la normalisation des relations du Maroc avec Israël. Elle a placé le pays le plus puissant du monde dans le camp du Maroc sur une question d’importance fondamentale pour le royaume, à un moment où les tensions sur le Sahara occidental s’étaient déjà ravivées après la rupture d’un cessez-le-feu de longue date entre le Maroc et le mouvement indépendantiste Front Polisario. Le réchauffement des liens entre le Maroc et Israël fait entrer pour la première fois cette puissance régionale polarisante dans le délicat équilibre des pouvoirs au Maghreb. De son côté, l’Algérie a récemment mené des exercices militaires conjoints en Ossétie du Sud avec la Russie, qui fournit depuis longtemps une grande partie des armes de l’Algérie.
Il existe de nombreux cas dans l’histoire récente du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord dans lesquels l’implication de puissances extérieures a conduit à l’escalade du conflit. Cependant, il y a également des raisons de penser que l’impasse entre l’Algérie et le Maroc pourrait rester contenue. Les deux pays ont des raisons d’éviter un conflit ouvert, notamment le besoin urgent de se concentrer sur les préoccupations économiques nationales. Un autre facteur important est que de nombreux partenaires extérieurs importants ont des liens avec les deux pays et ont intérêt à atténuer les tensions plutôt que de les attiser.
Les États européens et l’UE figurent en bonne place parmi ces partenaires. Ils jouent un rôle clé en Afrique du Nord en raison de leurs liens historiques, de leur proximité et de leurs liens économiques avec la région. L’UE et ses États membres pourraient contribuer à réduire les tensions entre le Maroc et l’Algérie – mais pour ce faire, ils doivent maintenir une position équilibrée dans leurs relations avec les deux pays. Au lieu de cela, les dirigeants européens semblent souvent peu disposés à s’opposer aux exigences du Maroc, encourageant ainsi ses politiques maximalistes et sapant leur crédibilité auprès de l’Algérie. Plus récemment, l’Espagne a changé de politique pour approuver le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, suite à une campagne de pression marocaine soutenue qui comprenait l’envoi de vagues de migrants sur le territoire espagnol.
Laisser le Maroc définir les termes de ses relations avec l’UE risque d’encourager le pays à s’affirmer encore plus et de projeter une image de faiblesse stratégique qui va à l’encontre de l’objectif de l’UE de devenir une puissance géopolitique. Elle compromet également sa capacité à jouer un rôle modérateur en Afrique du Nord et menace ainsi de nuire aux intérêts européens plus larges dans la région. L’UE devrait recalibrer ses politiques afin de mieux réaliser ses ambitions à long terme dans ses relations avec le Maroc et l’Algérie, notamment en influençant la dynamique de l’escalade entre les deux rivaux.
L’évolution des relations algéro-marocaines
Les mouvements indépendantistes algériens et marocains ont entretenu des liens étroits, mais lorsque l’Algérie a rejoint le Maroc en tant qu’État indépendant en 1962, les relations entre les pays se sont rapidement détériorées[1]. La cause immédiate des frictions était un différend frontalier portant sur un morceau de territoire désertique que les administrateurs coloniaux français avaient attribué à l’Algérie et que le Maroc cherchait à récupérer après l’indépendance des deux pays. Les tentatives marocaines de s’emparer de ce territoire en 1963 ont entraîné une brève flambée de combats entre les deux pays, surnommée la « guerre des sables ». Après quelques semaines, alors que l’on craignait que l’implication de puissances extérieures ne conduise à une nouvelle escalade, les parties ont convenu d’un cessez-le-feu grâce à des négociations menées par l’Éthiopie et le Mali. Néanmoins, les tensions ont persisté. Cela s’explique en partie par les différences idéologiques entre la monarchie conservatrice du Maroc et le rôle prépondérant de l’Algérie en tant que soutien des mouvements révolutionnaires du tiers-monde, mais un facteur plus important était probablement leur rivalité géopolitique pour le rôle de leader dans la région. Selon l’historien britannique Michael Willis, les tensions persistantes entre le Maroc et l’Algérie sont « enracinées dans des différences sur des questions plus profondes que l’idéologie »[2].
Depuis 1975, la question dominante entre les deux pays est le conflit du Sahara occidental. Après le retrait des forces de l’ancienne puissance coloniale espagnole et le transfert du contrôle du territoire au Maroc et à la Mauritanie, l’Algérie a apporté son soutien aux revendications d’autodétermination du peuple sahraoui et au mouvement Polisario qui lutte en son nom. L’Algérie avait été réticente à soutenir la position du Polisario avant le retrait de l’Espagne et semblait même disposée à accepter les revendications du Maroc en échange du règlement de son propre différend frontalier avec ce pays. Cependant, une fois que le Maroc s’est emparé de la majeure partie du Sahara occidental, l’Algérie a commencé à fournir un soutien militaire au Polisario et a permis à ses dirigeants (ainsi qu’à de nombreux réfugiés sahraouis) de s’établir sur le territoire algérien ; il y a même eu des escarmouches en 1976 entre les forces marocaines et algériennes sur le territoire. Comme Hugh Lovatt et Jacob Mundy l’ont écrit pour l’ECFR, l’Algérie était motivée en grande partie par « la menace stratégique qu’elle voyait de plus en plus dans un Maroc enhardi et expansionniste ». L’Algérie a également été l’un des principaux soutiens diplomatiques de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), l’État proclamé par le Polisario en 1976.
Avec le soutien de l’Algérie, le Polisario a pu causer de sérieux problèmes aux forces marocaines au Sahara occidental, mais le conflit s’est stabilisé au milieu des années 1980 après la construction par le Maroc d’un énorme mur de sable, ou berme, le long de la frontière du territoire qu’il contrôle. Dans la dernière partie de la décennie, les tensions entre l’Algérie et le Maroc se sont apaisées. Les relations diplomatiques, que le Maroc avait rompues en 1976, ont été rétablies en 1988. Cette réconciliation partielle a à son tour rendu possible l’accord d’une nouvelle organisation régionale regroupant les cinq pays du Maghreb (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie), l’Union du Maghreb arabe (UMA), en 1989. En 1991, le Maroc et le Polisario ont convenu d’un plan de règlement pour le Sahara occidental sous les auspices de l’ONU, impliquant un cessez-le-feu sous surveillance de l’ONU et l’engagement d’organiser un référendum sur le statut du territoire dans les deux ans.
Cependant, le référendum promis n’a jamais eu lieu, en partie à cause de différends sur les personnes autorisées à voter. L’incapacité à progresser sur la question du Sahara occidental et la réaffirmation du contrôle interne par les militaires algériens (traditionnellement hostiles au Maroc) à la suite de l’annulation des élections de 1992 et de l’assassinat du président algérien six mois plus tard, ont entraîné une détérioration progressive des relations entre l’Algérie et le Maroc. Après que le Maroc a accusé l’Algérie d’être impliquée dans une attaque terroriste à Marrakech en 1994 et a imposé une obligation de visa aux Algériens se rendant au Maroc, l’Algérie a fermé la frontière entre les deux pays. Elle n’a jamais été rouverte, malgré les appels périodiques du Maroc à rétablir des relations normales. Loin de fournir un forum pour un engagement plus profond, l’UMA a été largement paralysée par la rivalité entre l’Algérie et le Maroc.
Comme il est devenu clair que le plan de règlement ne fournirait pas la base pour résoudre le statut du Sahara Occidental, les Nations Unies ont renouvelé leur recherche d’un accord négocié. Les envoyés successifs de l’ONU ont essayé de trouver un accord mutuellement acceptable – mais ont eu peu à montrer pour leurs efforts. Le Maroc et l’Algérie ont été en désaccord sur le format des négociations : Le Maroc, considérant le Polisario comme une création largement algérienne, a cherché à inclure l’Algérie ainsi que la Mauritanie dans les pourparlers, tandis que l’Algérie a insisté pour que des discussions bilatérales aient lieu entre le Maroc et le Polisario, ce dernier étant le représentant légitime du peuple sahraoui. En 2018 et 2019, grâce à une concession algérienne, des pourparlers ont eu lieu à Genève sous forme de table ronde, l’Algérie et la Mauritanie y participant avec le statut d’observateurs.
Les causes de la rupture
En 2017, le Maroc a réintégré l’Union africaine après une interruption de 33 ans, après avoir quitté son prédécesseur, l’Organisation de l’unité africaine, en 1984 pour protester contre l’admission de la RASD en tant que membre de l’organisation. Le retour du Maroc a été le signe d’une nouvelle énergie diplomatique et d’une confiance dans sa politique régionale, à un moment où la politique étrangère algérienne semblait stagner en raison de l’incapacité de son président malade, Abdelaziz Bouteflika. Le Maroc a également réussi à persuader une vague de plus de 20 pays arabes et africains d’ouvrir des consulats sur le territoire, indiquant ainsi leur acceptation de la revendication de souveraineté du Maroc.
Ces démarches diplomatiques ont été suivies par une réouverture des hostilités entre le Maroc et le Polisario en novembre 2020. Le Polisario a annoncé la fin du cessez-le-feu après que les forces marocaines ont traversé la zone tampon de Guerguerat, patrouillée par l’ONU, pour déloger des manifestants sahraouis qui, selon le Maroc, bloquaient le trafic de marchandises sur la route principale reliant le Maroc à la Mauritanie en passant par le Sahara occidental. Malgré l’action du Polisario, la décision de Trump, le mois suivant, de reconnaître la souveraineté marocaine sur le territoire semblait confirmer que la nouvelle affirmation du Maroc portait ses fruits. Mais, pour l’Algérie, le rapprochement du Maroc avec Israël est apparu comme une menace directe : Le Premier ministre algérien, Abdelaziz Djerad, a déclaré que l’Algérie avait été « visée » par « l’arrivée à ses portes de l’entité sioniste ». Lorsque le ministre israélien des affaires étrangères Yaïr Lapid s’est rendu au Maroc, il a critiqué le rôle de l’Algérie dans la région et s’est inquiété de ses liens avec l’Iran.
Dans ce contexte, deux autres actions marocaines ont semblé confirmer les affirmations algériennes selon lesquelles l’Algérie était confrontée à une plus grande menace de la part de son voisin. La publication d’une enquête journalistique détaillée sur l’utilisation mondiale du logiciel de piratage téléphonique Pegasus a montré que le Maroc avait espionné de manière extensive des cibles algériennes, ciblant plus de 6 000 personnes – une action particulièrement mal perçue car le logiciel a été développé par une société israélienne, NSO Group. Dans le même temps, le Maroc a lancé une campagne visant à renverser le soutien algérien au Polisario en promouvant la cause du mouvement séparatiste dans la région de Kabylie en Algérie. En juillet 2021, l’ambassadeur du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilale, a distribué une note affirmant que « le vaillant peuple kabyle mérite, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l’autodétermination. »
Ce fut la goutte d’eau qui a conduit l’Algérie à rappeler son ambassadeur, puis à rompre ses relations diplomatiques. Un diplomate algérien aurait déclaré que le Maroc avait touché à deux des plus grands tabous de la politique algérienne : son souci de l’unité nationale et sa politique envers Israël. L’Algérie a également accusé le Maroc et Israël d’avoir collaboré avec le groupe séparatiste kabyle MAK pour déclencher une série d’incendies de forêt qui ont causé d’importants dégâts au cours de l’été 2021. L’Algérie a pris de nouvelles mesures contre le Maroc à l’automne 2021, en fermant son espace aérien aux avions marocains et en mettant fin aux livraisons de gaz par le gazoduc Maghreb-Europe qui relie l’Algérie, le Maroc et l’Espagne – et qui fournissait le gaz utilisé pour environ un dixième de l’approvisionnement en électricité du Maroc.
Manœuvres militaires
L’élément le plus alarmant de cette impasse est la reprise des combats au Sahara occidental et la possibilité que l’Algérie et le Maroc entrent en conflit direct. Le Polisario a mis fin au cessez-le-feu en réaction à l’incursion du Maroc dans la zone tampon, mais sa décision répondait également à une impatience à plus long terme parmi les jeunes combattants du Polisario, frustrés par l’incapacité de la diplomatie à obtenir des résultats. Depuis lors, le conflit est resté à un faible niveau d’intensité, selon l’ONU. Les combattants du Polisario ont déclaré aux journalistes qu’ils avaient attaqué à plusieurs reprises des bases marocaines le long du mur de sable, mais rien n’indique que leurs actions aient causé de graves problèmes au Maroc. De son côté, le Maroc aurait utilisé des drones fournis par la Turquie et la Chine pour attaquer les combattants du Polisario dans la zone qu’ils contrôlent, notamment le chef de la gendarmerie du Polisario, Addah Al-Bendir, tué en avril 2021.
En novembre 2021, un convoi commercial de chauffeurs routiers algériens traversant la partie du Sahara occidental contrôlée par le Polisario a été touché par un attentat à la bombe apparent, tuant trois hommes. Dans une déclaration, l’Algérie a affirmé que l’attaque avait été menée par les forces marocaines à l’aide d’ »armes sophistiquées », laissant entendre qu’il s’agissait d’une attaque de drone. Le Maroc a nié toute responsabilité. Il s’agit d’un moment de danger dans l’impasse algéro-marocaine, et l’Algérie a averti que les meurtres « ne resteraient pas impunis ». Cependant, malgré sa rhétorique belliqueuse, l’Algérie n’a jamais fourni de preuve que le Maroc avait mené l’attaque, et elle ne semble pas avoir effectué d’acte de représailles. Rien n’indique non plus que l’Algérie ait intensifié de manière significative les livraisons d’armes au Polisario depuis la rupture du cessez-le-feu. Selon le Polisario, le soutien algérien se renforce, mais il y a peu de preuves de la livraison d’armes sophistiquées[3]. Les rapports sur les opérations du Polisario continuent de décrire une force de combat qui s’appuie sur un armement vieux de plusieurs décennies.
Tout échange militaire direct entre l’Algérie et le Maroc mettrait en conflit deux des plus grandes forces militaires d’Afrique. Une course aux armements entre les deux rivaux est déjà en cours, et tous deux ont des liens avec des fabricants d’armes de pointe. L’Algérie est un géant militaire : son budget de défense en 2020 était de 9,7 milliards de dollars, le plus important d’Afrique. Un peu moins de 70 % du matériel militaire algérien provient de la Russie. Elle devait recevoir cette année une commande de 14 avions d’attaque Su-34 et aurait discuté de l’achat du chasseur furtif Su-57. Le budget du Maroc est plus modeste, avec 4,8 milliards de dollars en 2020, mais cela représentait déjà une augmentation de 54 % depuis 2011, et les dépenses de défense devraient passer à 5,5 milliards de dollars en 2022. En outre, le Maroc est en pleine mise à niveau de ses forces, y compris un accord de défense aérienne de 500 millions de dollars avec Israël. Le Maroc et Israël ont signé un accord de défense en novembre 2021 qui engage les deux pays à coopérer en matière d’échange d’informations, de projets communs et de ventes d’armes.
Le jeu d’équilibre de l’Algérie
Malgré ces tendances, il serait erroné de voir une dynamique inévitable d’accroissement des tensions entre l’Algérie et le Maroc, ou que celles-ci soient principalement alimentées par la Russie et Israël. Du côté algérien, l’attachement de longue date du pays au principe de souveraineté et sa tradition de résistance à toute obligation susceptible de contraindre sa liberté d’action limitent l’influence qu’il a permis à la Russie d’obtenir. L’Algérie a refusé une série de demandes russes visant à obtenir l’autorisation de construire une base navale dans la ville côtière algérienne d’Oran. Elle a également acheté des armes à l’Allemagne et à l’Italie. Lors du vote de l’Assemblée générale des Nations unies sur une résolution condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Algérie a préféré s’abstenir plutôt que de soutenir la Russie. Le Maroc n’a pas voté du tout, espérant manifestement ne pas s’aliéner les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU dont il pourrait avoir besoin pour le Sahara occidental. Cela signifie que les positions des rivaux nord-africains n’étaient pas très différentes.
L’approche adoptée par l’Algérie en matière d’exportations de gaz à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie témoigne également d’une volonté d’équilibrer ses relations avec la Russie et d’autres partenaires, en plus de servir ses propres intérêts économiques. L’Algérie fournissait 11 % du gaz européen avant la guerre et, dès le début de celle-ci, elle a proposé d’augmenter ses livraisons via le gazoduc transméditerranéen reliant l’Algérie à l’Italie afin de compenser toute insuffisance des livraisons européennes en provenance de la Russie. Le directeur de la compagnie gazière publique algérienne Sonatrach, Toufik Hakkar, a déclaré dans une interview au journal algérien Liberté que l’Algérie était « un fournisseur de gaz fiable pour le marché européen et qu’elle était prête à soutenir ses partenaires à long terme au cas où la situation se détériorerait ». Toutefois, après que ses commentaires ont été largement rapportés, Sonatrach s’est plainte qu’ils avaient été déformés par le journal – un signe apparent que l’Algérie n’était pas prête à rompre trop publiquement avec la Russie.
Depuis l’arrivée d’Abdelmadjid Tebboune à la présidence de l’Algérie en décembre 2019, le pays a tenté de revitaliser sa politique étrangère. Cela a impliqué une réponse plus forte aux mouvements marocains, mais aussi le renouvellement des liens avec des partenaires qui ne soutiendraient pas une nouvelle escalade. L’une des priorités de M. Tebboune a été de redonner à l’Algérie une place plus centrale dans la diplomatie arabe en organisant un sommet réussi de la Ligue arabe. Reporté de mars 2022, le sommet a maintenant été confirmé pour novembre 2022. Tebboune a intérêt à ce que de nombreux dirigeants arabes y assistent, ce qui l’incitera à éviter toute action provocatrice à l’encontre du Maroc.
L’Algérie a également renforcé ses liens avec la Turquie et entretient des liens de longue date avec la Chine. Ces deux pays entretiennent de bonnes relations avec le Maroc et ne profiteraient pas d’une augmentation des tensions entre les deux rivaux nord-africains. L’Algérie a également une relation de sécurité bien développée avec les États-Unis, qui a persisté malgré la reconnaissance par Trump de la revendication du Maroc sur le Sahara occidental. Rien qu’en mars 2022, de hauts responsables américains du département de la défense et du département d’État se sont rendus en Algérie pour un dialogue militaire et un dialogue stratégique conjoints. Enfin, l’Algérie est fortement dépendante de l’Europe pour son commerce extérieur : l’UE est le premier partenaire commercial de l’Algérie et représente 46,7 % des exportations algériennes (principalement des hydrocarbures).
Ainsi, la politique étrangère algérienne est marquée par une « géométrie variable », selon les termes de l’analyste franco-algérien Akram Belkaid. Le pays combine une position robuste par rapport au Maroc (ainsi que dans sa rhétorique envers l’ancienne puissance coloniale, la France) avec une approche plus pragmatique avec d’autres partenaires, tout en préservant toujours un certain degré d’autonomie. Le chercheur Adlene Mohammedi a récemment écrit que « malgré des discours parfois controversés, la politique étrangère de l’Algérie se caractérise essentiellement par la discrétion et la prudence. » Ce positionnement signifie qu’il est peu probable qu’elle pousse sa confrontation avec le Maroc à un niveau tel qu’elle met en péril d’autres relations de politique étrangère. De manière cruciale, il fournit également une ouverture pour les partenaires, y compris l’Europe et les États-Unis, pour promouvoir la désescalade.
La politique étrangère algérienne ne peut être comprise indépendamment de la politique intérieure du pays. Le mouvement de protestation du Hirak qui a explosé en 2019 s’est calmé face à une répression ciblée contre les militants. Cependant, le soutien populaire au régime semble limité : une indication est que la participation aux élections législatives de juin 2021 n’a été que de 23 %. Traditionnellement, les élites dirigeantes algériennes considéraient la politique dure à l’égard du Maroc comme un moyen de rallier le soutien nationaliste au régime algérien, mais il n’est pas clair dans quelle mesure cela reste le cas. Si l’establishment politique et l’armée qui le soutient ont toujours eu des opinions fortement anti-marocaines, la méfiance de la population à l’égard des autorités et sa préoccupation pour les problèmes socio-économiques sont susceptibles de limiter les avantages politiques qu’une position agressive contre le Maroc peut apporter.
D’après le politologue Zine Labidine Ghebouli, la politique étrangère algérienne et l’opinion publique sur le rôle du pays sont en pleine évolution[4]. Alors que les parties les plus conservatrices de la population restent attachées à une vision traditionnelle du rôle de l’Algérie axée sur le soutien à l’autodétermination, il existe également une partie croissante de l’opinion qui est plus sceptique à l’égard des récits officiels et plus sensible à la nécessité d’un soutien économique et d’un investissement accru. Alors que l’opposition algérienne à Israël reste très répandue, il n’est pas certain que le gouvernement considère une nouvelle confrontation avec le Maroc comme un atout politique incontestable.
Il est certain que l’Algérie réagira à toute nouvelle mesure marocaine qui pourrait être considérée comme une provocation. Elle a continué à envoyer des convois commerciaux à travers le Sahara Occidental à la suite de la récente attaque, et il ne fait aucun doute qu’une nouvelle attaque contre des citoyens algériens recevrait une réponse forte. Mais en l’absence de toute nouvelle escalade du côté marocain, l’Algérie pourrait bien se contenter de maintenir ses initiatives contre le Maroc au niveau de la rhétorique.
Le Maroc – une stratégie d’affirmation de soi
Ces dernières années, et en particulier depuis la reconnaissance par Trump de sa souveraineté sur le Sahara occidental, le Maroc agit avec une affirmation de plus en plus marquée, non seulement à l’égard de l’Algérie mais aussi de l’Europe. En mars 2021, le Maroc a rompu sa coopération diplomatique avec l’Allemagne et a ensuite rappelé son ambassadeur en réponse à ce qu’il a décrit comme « l’attitude destructrice » de l’Allemagne sur le Sahara occidental, qui a notamment demandé une audience à huis clos du Conseil de sécurité de l’ONU après la décision de Trump. En avril 2021, le Maroc s’est également engagé dans une querelle diplomatique avec l’Espagne suite à la décision de Madrid de permettre au leader du Polisario Brahim Ghali d’entrer en Espagne pour être traité pour le covid-19. Dans le cadre de sa réponse, le Maroc a parfois facilité le passage de migrants en territoire espagnol sur la côte nord-africaine, notamment dans les villes de Ceuta et Mellila.
En novembre 2021, le roi Mohammed VI a prononcé un discours dans lequel il a affirmé avec force que la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ne ferait jamais l’objet de négociations, la décrivant comme « une vérité aussi pérenne qu’immuable ». Il a également averti que le Maroc n’accepterait jamais aucune initiative économique ou commerciale qui exclurait le Sahara Occidental. Ceci a des implications évidentes pour les relations du Maroc avec l’Europe. Deux mois plus tôt, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJEU) avait jugé que deux accords de commerce et de pêche entre l’UE et le Maroc étaient invalides parce qu’ils s’étendaient aux produits originaires du Sahara Occidental sans que le consentement du peuple sahraoui ait été demandé pour ces accords. Le Conseil de l’Union européenne a voté pour faire appel de la décision, mais il est probable que la décision sera confirmée. Il est difficile de voir comment les accords pourraient être révisés de manière à satisfaire à la fois les demandes du Maroc et les conditions de la cour.
Néanmoins, les politiques énergiques du Maroc ont obtenu certains résultats. Plus particulièrement, il a été révélé en mars 2022 que le premier ministre espagnol avait écrit une lettre au Roi Mohammed VI disant que le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara Occidental était « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour résoudre le conflit. Cela a marqué un changement majeur dans la position de l’Espagne, puisqu’elle était auparavant restée neutre entre les propositions du Maroc et du Polisario et avait seulement appelé à une solution négociée sous les auspices de l’ONU. La démarche espagnole s’inscrit dans le cadre d’une réconciliation avec le Maroc, ouvrant ce que les autorités espagnoles ont appelé une « nouvelle étape » dans les relations entre les deux pays.
On pourrait arguer que le changement de position de l’Espagne a peu d’impact sur le fond, puisqu’un accord devra encore être trouvé par le biais de négociations. Mais la décision de l’Espagne risque d’envoyer un signal au Maroc, lui indiquant qu’il bénéficie d’un soutien international croissant pour son approche intransigeante. L’Allemagne avait auparavant réglé son différend avec le Maroc en des termes plus neutres, avec une déclaration décrivant le plan d’autonomie du Maroc comme « une contribution importante ». Le président Joe Biden a également permis que la reconnaissance de la souveraineté marocaine par Trump soit maintenue, bien que son administration ait largement suivi une politique consistant à éviter le sujet et à soutenir la reprise des négociations sous l’égide de l’envoyé des Nations unies récemment nommé, Staffan de Mistura. Les États-Unis semblent avoir obtenu le soutien du Maroc pour la nomination de Mistura en partie en évitant de revenir sur la décision de Trump.
Vers une approche européenne plus équilibrée
Toute nouvelle détérioration des relations entre l’Algérie et le Maroc pourrait avoir des conséquences importantes pour l’Europe. Un conflit entre les deux pays entraînerait probablement une forte augmentation de la migration vers l’UE, et surtout vers l’Espagne. Il aurait un impact profondément déstabilisant dans l’ensemble des régions du Maghreb et du Sahel, faisant reculer les espoirs européens de développement économique en Afrique du Nord, qui pourrait jouer un rôle important dans la transition verte de l’Europe, entre autres intérêts. Un conflit pourrait également permettre à des groupes extrémistes de gagner du terrain.
La récente montée des tensions entre le Maroc et l’Algérie découle d’une série de changements qui ont bouleversé le statu quo antérieur. Le meilleur espoir pour l’Europe d’aider à stabiliser leurs relations réside dans le maintien d’une approche équilibrée vis-à-vis des deux pays, afin d’éviter d’encourager davantage l’affirmation marocaine ou la défensive algérienne. Bien sûr, l’UE a des liens plus développés avec le Maroc qu’avec l’Algérie – et cela est particulièrement vrai pour la France et l’Espagne, qui ont des liens commerciaux forts et comptent sur la coopération marocaine en matière de migration et de contre-terrorisme. Cependant, il y a des raisons de se méfier d’une adhésion trop étroite à la position du Maroc. Pour l’Europe, faire des concessions face aux tactiques musclées du Maroc risque de récompenser une approche qui incorpore un élément de chantage par la militarisation de la migration. En outre, l’engagement européen avec le Maroc n’a pas réussi à obtenir le soutien marocain à la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’invasion russe de l’Ukraine – une question d’importance critique pour l’Europe.
Le Maroc pourrait également être dans une position plus faible que sa position affirmée semble le suggérer. La guerre en Ukraine a déjà un impact sérieux sur l’économie du pays. Le Maroc est un grand importateur de céréales et d’hydrocarbures, dont le prix a fortement augmenté en raison du conflit. Le Maroc souffrait déjà de la pire sécheresse depuis des décennies, ce qui a eu un impact considérable sur la production agricole nationale. L’industrie touristique du pays est également encore en train de se remettre de l’impact du covid-19.
Ces facteurs rendent le soutien européen et la poursuite des flux commerciaux du Maroc vers l’Europe particulièrement importants. Si la CJUE confirme le récent arrêt sur les accords commerciaux et de pêche, il serait coûteux pour le Maroc de perdre les avantages de son accord d’association avec l’UE, qui est la destination de 64 % des exportations marocaines. Le Maroc pourrait finalement être contraint de faire un compromis sur son insistance à ce que tout accord commercial inclue le Sahara Occidental ; dans tous les cas, le jugement de la cour impose une limite à ce que l’UE peut accepter. Cela pourrait fournir une occasion de réinitialiser les relations de l’Europe avec le Maroc, en s’éloignant d’une posture qui semble souvent excessivement déférente. Si l’Europe ne riposte pas à l’affirmation marocaine, le Maroc sera encouragé à redoubler ses exigences et ne sera pas incité à respecter les préoccupations européennes.
L’UE et ses Etats membres devraient adopter une politique envers le Maroc qui soit basée sur une évaluation des intérêts à long terme de l’Europe envers le pays et le Maghreb plus largement. L’Europe peut reconnaître les avantages de la coopération et les contributions marocaines dans des domaines tels que la migration et la sécurité, mais dans le même temps, elle peut indiquer clairement qu’elle n’est pas prête à approuver la position du Maroc sur le Sahara occidental et qu’elle attend également une coopération sur d’autres préoccupations européennes. Dans le cadre de cette politique, l’Europe devrait encourager la retenue marocaine dans l’utilisation de la force contre les forces du Polisario et souligner l’importance d’éviter une nouvelle escalade dans les relations du Maroc avec l’Algérie. Elle devrait essayer d’atténuer le sentiment du Maroc qu’il peut atteindre ses objectifs au Sahara occidental en s’affirmant davantage, une perception qui sous-tend ses tensions avec son voisin.
Les relations européennes avec l’Algérie sont beaucoup moins profondes que celles avec le Maroc. Le pays est à bien des égards un partenaire plus problématique et plus délicat : son gouvernement ne bénéficie pas d’un soutien populaire, son climat commercial décourage les investissements européens et il n’a pas respecté les engagements pris dans son accord d’association avec l’UE en 2002. Néanmoins, l’UE reste un partenaire important pour l’Algérie, et elle pourrait gagner encore en influence si le pays s’engage dans la transition économique et énergétique qui sera nécessaire pour assurer sa prospérité future.
Il est dans l’intérêt de l’Europe de développer ses liens avec l’Algérie et d’éviter de pousser le pays à dépendre davantage de puissances extérieures telles que la Russie. L’UE et ses Etats membres seront les mieux placés pour le faire s’ils ne s’alignent pas davantage sur la position du Maroc sur le Sahara occidental. Le récent changement de position de l’Espagne a incité l’Algérie à rappeler son ambassadeur pour des consultations et à revoir le prix qu’elle facture à l’Espagne pour le gaz, bien qu’il ne soit pas encore clair dans quelle mesure une rupture des relations en résultera. Les pays européens devraient éviter toute nouvelle action qui semble prendre parti dans le conflit, ce qui perturberait davantage l’équilibre des pouvoirs perçu entre le Maroc et l’Algérie d’une manière potentiellement déstabilisante. Dans le même temps, l’UE devrait essayer de persuader l’Algérie de revenir au format quadripartite pour les pourparlers sur le Sahara Occidental, dans le cadre d’un effort pour soutenir la volonté de l’envoyé de l’ONU de relancer les négociations. Les responsables européens devraient également essayer de persuader l’Algérie de ne pas intensifier son soutien militaire au Polisario et d’éviter toute nouvelle rhétorique incendiaire à l’égard du Maroc.
Il n’existe aucune perspective immédiate de pourparlers bilatéraux visant à désamorcer l’impasse entre le Maroc et l’Algérie, et il est peu probable que les pays européens soient acceptés par l’une ou l’autre des parties en tant que médiateurs. Mais l’UE et ses États membres pourraient jouer un rôle dans la réduction des tensions s’ils peuvent contribuer à encourager une approche plus modérée des deux côtés. Pour ce faire, ils doivent envisager leurs relations avec les deux pays dans un contexte régional et éviter toute action supplémentaire qui pourrait alimenter l’affirmation marocaine et amener l’Algérie à penser que l’Europe a pris parti contre elle. Une telle approche permettrait non seulement à l’Europe d’être la mieux placée pour désamorcer les tensions régionales, mais fournirait également la base la plus constructive pour les relations bilatérales avec le Maroc et l’Algérie dans les années à venir.
A propos de l’auteur
Anthony Dworkin est chargé de mission au Conseil européen des relations étrangères. Il dirige les travaux de l’organisation dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et de l’ordre international. Entre autres sujets, Dworkin a mené des recherches et écrit sur le soutien de l’Union européenne au multilatéralisme, la transition politique en Afrique du Nord et les cadres européen et américain de lutte contre le terrorisme.
Remerciements
L’auteur tient à remercier Zine Labidine Ghebouli pour sa connaissance de la politique étrangère algérienne. Au sein de l’ECFR, il souhaite remercier Julien Barnes-Dacey, Hugh Lovatt et Tarek Megerisi pour leurs commentaires sur une version antérieure, ainsi qu’Adam Harrison pour l’édition.
Cet article a été rendu possible grâce au soutien du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’ECFR par la Fondazione Compagnia di San Paolo.
[1] Pour un compte rendu des relations entre l’Algérie et le Maroc, voir Michael Willis, Politics and Power in the Maghreb : Algeria, Tunisia and Morocco from Independence to the Arab Spring (Hurst, 2012), pp. 265-292.
[2] Willis, Politics and Power in the Maghreb, p. 292.
[3] Entretien de l’ECFR avec un haut responsable du Polisario, capitale européenne, octobre 2021.
[4] Entretien de l’ECFR avec Zine Labidine Ghebouli, 28 février 2022.
The European Council on Foreign Relations, 08/04/2022
#SaharaOccidental #Algérie #Maroc #UE #Migration