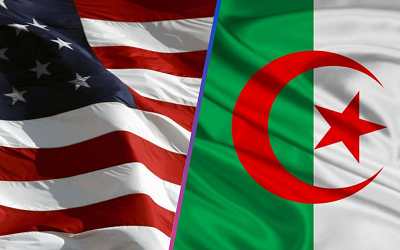Algérie, Etat rentier, énergie, gazoduc Nigeria-Algérie, gaz, pétrole,
Le potentiel énergétique de l’Algérie est énorme. Avec ses réserves, conventionnelles et non-conventionnelles, notre pays est en mesure de jouer les premiers rôles dans l’arène du marché mondiale de l’énergie… Pour y arriver, le chemin est long, très long. Le Dr Ali Kefaifi, expert de stature internationale, analyse les tenants et aboutissants.
1- Que pèse aujourd’hui l’Algérie sur le marché gazier mondial ?
Dès l’aube de l’indépendance, avec l’usine Camel (usine GNL d’Arzew, démarrée sous la direction de M Chanderli ex Ambassadeur GPRA à New York) l’Algérie fut reconnue comme acteur important de ce marché gazier dont le développement comme substitut au pétrole allait marquer sans l’imaginer, la fin de la domination pétrolière vers 2050.
En fait, grâce à son volontarisme exceptionnel, et dès l’indépendance , l’Algérie industrieuse et industrielle développa ses richesses humaines et naturelles, se plaça parmi les tout premiers pays gaziers dans le monde, et ce sur l’ensemble de la chaîne gazière : Upstream , avec des réserves prouvées de 4500 milliards m3 ,dont 50 % avec le champs gazier de Hassi R Mel (gisement “Eléphant” très rentable grâce aux Condensats Associés), Midstream avec les gazoducs vers le Nord (Arzew, Skikda, Issers ) et l’intérieur (réseau domestique), GNL avec les usines de liquéfaction (Usine dite Camel à Arzew qui fut dès 1964 la PREMIÈRE usine de GNL du monde), Aval Pétrochimique de valorisation du gaz naturel conçu et lancé dès 1965-1969, à travers les usines d’Engrais (Arzew puis Annaba) ) , de Méthanol ( matière de base de la chimie et pétrochimie) et du Complexe Pétrochimique de Skikda (éthylène, polyéthylènes, PVC pour véhicules et infrastructures ) .
Depuis 2000, l’Algérie Gazière, malgré un Potentiel Actualisé de 700 000 milliards m3 de gaz de roche mère, correspondant à 70 000 milliards m3, soit le 1/3 des Ressources Techniquement Extractibles mondiales, nonobstant le pétrole de roche mère à l’image du sous-sol libyen géologiquement proche, l’Algérie a continuellement régressé sur ses marchés (UE, USA ). Cependant durant 20 années l’Etat Rentier a totalement raté le coche, du fait de l’absence de planification, les gabegies et les prébendes, les surfacturations (+ 200 %), les graves déséquilibres financiers internes et externes devenus un standard dans le secteur énergétique (GNL, centrales électriques, etc.) ). La bureaucratie et l’incompétence n’ont pas su ou voulu exploiter les opportunités classiques comme dans le monde, par la Récupération Tertiaire (Microbio, CO2 d’In Salah,etc) pour récupérer 50 % du gaz associé (Hassi Messaoud, Rhourde El Baghel) soit + de 50 milliards m3, exploration dans les zones “frontières géologiques” du NW et du NE algériens , 50 % des capacités GNL inutilisées , filière GNL non compétitive face au Qatar, aux USA, absence totale de valorisation pétrochimique du gaz (gaz naturel, éthane , propane, butane)
Pour garder la tête hors de l’eau en 2025, et préserver les ressources budgétaires internes (fiscalité pétrolières 30 %) et externes (95 à 98 %), l’Algérie est condamnée à adopter une nouvelle politique énergétique (contrainte critique), économique (optimisation globale), sociale (politique de subvention, emploi, développement, diversification), et géostratégique régionale.
2- Quelles sont les perspectives du secteur algérien de l’énergie ? (Gaz, pétrole, Gaz et pétrole de schiste et renouvelables)
Globalement, et nonobstant les nombreux défis et challenges (concurrences mondiales et régionales, bureaucratie , incompétence, gouvernance), les perspectives énergétiques algériennes sont incommensurables à l’échelle du 21 e siècle car, grâce au SAHARA, sa géologie pétrolifère (anciens océans et dépôts depuis 500 à 250 millions d’années, puis idem jusqu’à 60 millions) source d’ hydrocarbures non conventionnels (tight oil, pétrole de schistes, gaz non conventionnels, etc.), et de nombreux minerais métalliques et industriels , dont le potentiel est immense .
Considérant que le pétrole a marqué 200 ans depuis Bakou (Russie 1850) et la Pennsylvanie du Colonel Drake (USA 1859), le gaz naturel (génération électrique, transport GNV, Hydrogène vert, matière première et énergie pour la pétrochimie et l’industrie, etc.) demeurera une ressource recherchée et valorisée durant ce 21 e siècle, voire au-delà. Ces applications du gaz constitueront pour l’économie algérienne des leviers de croissance importants sur le plan de la rentabilité et de la compétitivité, avec des risques réduits du fait de l’importance des avantages comparatifs.
3- L’Algérie est-elle en mesure d’exploiter le gaz de schiste ? a-t-elle les moyens humains et techniques ?
Du fait de l’hégémonie bureaucratique, l’Algérie du secteur étatique n’est pas en mesure d’exploiter les hydrocarbures non conventionnels HCNC (pétrole de schiste , gaz de schiste et , à un degré moindre , tight oil) car jusqu’à présent cette exploitation passe par l’utilisation combinée des forages horizontaux et de la fracturation hydro-chimique des roches magasins qui emprisonnent l’hydrocarbure HCNC à cause des faibles porosités (ou “trous”) et perméabilités (ou “voies microscopiques de déplacement” des gouttelettes d’hydrocarbures).
Dans le monde, en gros seuls 4 pays ont affronté l’exploitation des pétroles et gaz de schistes, mais avec des fortunes diverses : USA, Argentine, Chine et Pologne. Après expérimentation, la Pologne a mis un frein pour des raisons économiques (potentiel, typologie, rentabilité) et environnementales. La Chine, qui dispose d’un potentiel appréciable (3ème mondial), a engagé un programme d’exploitation, mais ralenti malgré ses besoins gaziers, à cause des contraintes de rentabilité et environnementales, et de la difficulté du système chinois d’entreprises d’Etat qui n’ont pas su tirer profit du modèle technologique et économique US. L’Argentine, dont les ressources HCNC sont attrayantes, ont réussi à exploiter leur potentiel et produire l’équivalent de presque la moitié de la production en pétrole conventionnel de Hassi Messaoud, et ce après une demi-douzaine d’années.
Enfin , l’expérience US et de ses 700 sociétés privées (exploitation et services de HCNC) , qui constitue une réussite totale grâce à la politique énergétique des USA ( dès 1980 financement des travaux de R/D d’une société créée par un immigré grec Mitchell ) qui a permis dès 2006 de commencer à produire assez de pétrole de schiste (+ 7 milliards Barils aujourd’hui et quasi indépendance aujourd’hui) et de gaz de schiste (900 à 1000 milliards de gaz conventionnel + schiste ) qui transforme les USA en grand exportateur mondial de GNL, alors qu’il y a 20 ans , avec 600 milliards m3, soit seulement 3 fois la production gazière algérienne, il était importateur.
L’analyse de ces expériences étrangères et de la réalité algérienne (durée forage puit horizontal > 1 mois 1/2 par filiale Sonatrach contre 4 jours aux USA) montre que, malgré son potentiel, l’Algérie du secteur étatique n’est pas en mesure de se lancer, mutatis mutandis, dans l’exploitation des HCNC (gaz ou pétrole de schiste). L’échec environnemental, économique, financier, stratégique et territorial serait désastreux. Cependant, à la lumière des 4 expériences citées, et du diagnostic stratégique (forces, faiblesses, défis, challenges), il est recommandé une politique énergétique HCNC assise sur une évolution du type Courbe Logistique (courbe en S), avec en première étape 2022-2025 (évolution technologie dont Plasma, choix territoires, contrats de services à risques, ouvertures totales aux secteurs privés algériens et étrangers, et mixtes dont PPP). Dans l’immédiat, sur le plan R/D, l’Algérie devrait lancer 4 importants projets : Récupération Tertiaire à HMD et Rhourde El Bagel, Technologie alternative pour l’exploitation des HCNC (plasma, etc.), GNV pour véhicules et GNL pour transports lourds (camions, bus, locomotives, navires), exploration de gisements “frontières technologiques” du Nord Algérien.
4- Comment analysez-vous la situation énergétique mondiale à la lumière de la guerre russo-ukrainienne ?
Globalement, 2 évènements concomitants sont venus bouleverser les marchés énergétiques mondiaux : le déséquilibre offre demande, tant pétrolier depuis Avril 2020 (effets de la politique des pays OPEP+) que gazier comme conséquence sur les marchés UE et Asie, puis les effets de la guerre en Ukraine (approvisionnement gazier russe), le tout amplifié par l’effet de substitution entre les différentes formes d’énergie (gaz, pétrole, charbon). Le déséquilibre offre- demande pétrolière s’est traduit par des prix (Brent) qui sont passés progressivement de 40 $/bbl en 2020 à 110 $/bbl actuellement. Le déséquilibre pétrolier a, outre la politique OPEP+, 2 causes profondes. Une cause structurelle liée à la baisse des investissements pétroliers du fait de la diminution des prospects pétroliers observée depuis 2 voire 3 décennies. Depuis quelques années, la stagnation volontaire de la production du pétrole de schiste américain, conséquence de la politique financière adoptée (effet prix vs parts de marché du swing-partner américain) et qui a vu 2 à 3 milliards de barils en moins.
Le modèle d’équilibre énergétique est devenu complexe d’où la volatilité des prix, dont le gaz, pétrole et les produits pétroliers (gasoil, essence) à la hausse avec des spreads (ou écarts) très élevés. Ainsi, à 110 $/bbl, les prix du pétrole excèdent les coûts des pétroles marginaux (90 $/bbl pour les asphaltes canadiens ou 80 $/bbl pour les schistes US marginaux ou l’off-shore marginal).
Pour le gaz naturel, les prix sont différents selon les marchés : US (6 à 7 $/MM Btu voire 1 à 2 $/MM Btu pour le gaz de schiste des Appalaches), Asie (GNL 25 $/MM Btu) et UE (GNL à30 $/ MM Btu).
Si la crise russo- ukrainienne et ses effets s’estompaient à l’hiver 2022-2023, cette volatilité des prix retrouverait les niveaux de 2021 puis évoluerait selon les options profondes (stagflation 2024 ?, EnR vs pétrole fossile, future COP 27 au Caire, etc.)
5- Un grand projet de gazoduc devrait relier le Nigéria à l’Europe via l’Algérie ? Quelle serait son importance pour l’Algérie ? Un tel projet a-t-il de l’avenir ? Irait-on jusqu’au bout ?
Le projet de gazoduc Nigéria- Algérie – UE présenterait des avantages certains, dans l’absolu et par rapport aux autres options, y compris le GNL (effet distance inférieure à 5 000 km en faveur du gazoduc algérien). Ce projet pour le transport de GN serait compétitif par rapport aux autres options car l’Algérie dispose déjà d’un réseau de gazoduc, de vastes ressources gazières d’où effet d’économies d’échelles, de l’expérience technologique (gestion de pipe-line, décarbonatation du GN, exploitation Hydrogène bleu).
6- Jusqu’à quel degré l’Europe pourrait-elle s’affranchir du gaz russe ?
A moyen terme, l’UE restera fortement dépendante du gaz russe. Deux années seront nécessaires pour la construction des usines de regazéification de GNL, cependant le marché mondial resterait tendu avec des niveaux de prix qui rendraient le GNL moins compétitif que le pétrole. Aujourd’hui le GNL US livré en Europe coûte 30 $/ MM Btu (soit 168 $/baril équivalent) alors qu’aux USA il coûte 6 à 7 $/MM Btu) d’où les surcoûts et la perte de compétitivité industrielle de l’UE et, partant, les opportunités à saisir par l’Algérie à l’horizon 2023/2025+ (gaz naturel, hydrogènes bleu et vert, co-industrialisation, développement des chaînes de valeur).
7- Comment imaginez-vous la position de l’Algérie ? et comment verriez-vous sa ligne de conduite ?
En 2022, face à un marché gazier mondial en croissance et devant remplacer le pétrole (hors pétrochimie) à l’horizon 2050, l’Algérie qui fut le 1er exportateur mondial de GNL ,dispose aujourd’hui d’un potentiel énorme (4ème mondial pour les réserves conventionnelles et 1er pour les réserves de gaz de schistes) mais se retrouve reléguée après la 10e place dans les exportations gazières mondiales, derrière l’Australie, le Qatar, la Russie, les USA , car , contrairement à ces 4 pays, les exportations algériennes sont dramatiquement réduites au quart de sa production gazière totale , à la moitié de la consommation interne de Sonatrach (consommations gazières moyennes du secteur pétrolier 10 % dans le monde mais 50 % en Algérie )
L’Algérie se retrouve face à des opportunités exceptionnelles avec ses avantages comparatifs en ressources humaines et naturelles, ainsi que les nouvelles opportunités du marché UE. En tenant compte des principales contraintes critiques des dernières décennies, il est recommandé de réinstaurer la Planification Stratégique et d’ouvrir la sphère économique en privilégiant les objectifs universels (valeur ajoutée, emplois, compétitivité, technologie/RD, chaines de valeurs, équilibres internes et externes, équités).
Pour ce faire, l’Algérie doit adopter ce qui a fait le succès des pays émergents et développés : la planification, la gouvernance (ESG), les standards horizontaux et verticaux universels, la stabilité, l’ouverture concurrentielle, le secteur privé, le développement technologique et la R/D, etc.
Entretien réalisé par : Mohamed Bouazdia
La Nation,18/05/2022
#Algérie #Energie #Gaz #Pétrole #Transaharien #Nigeria