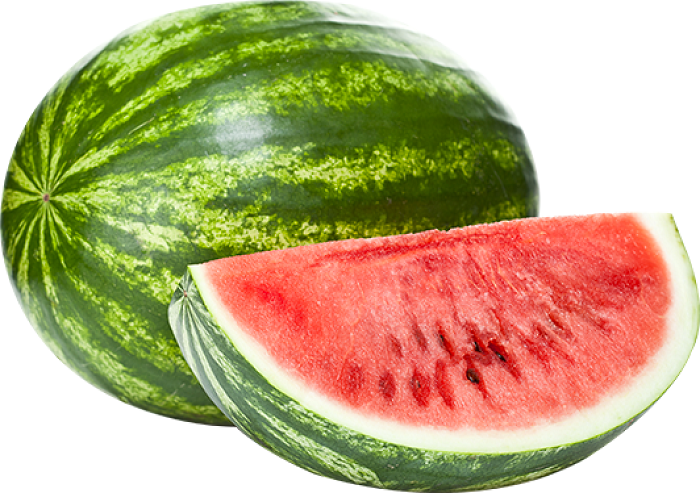Etiquettes : Maroc, mégapole, tomates, agriculteurs espagnols, Sahara Occidental, Union Européenne, agrculteurs français, prix, main d’oeuvre,
- Coag dénonce le fait que les entreprises proches de Mohamed VI et du ministre marocain de l’agriculture exploitent des terres fertiles dans les territoires occupés
- Almeria a perdu 2 200 hectares de culture en 5 ans en raison de la pression croissante des importations
Según El Economista, le roi du Maroc construit illégalement la tomate mégapolis à Dakhla aux dépens des Sahraouis et des fermiers du sud-est de l’Espagne. C’est ce qui est révélé dans le rapport de recherche présenté ce matin par l’ONG Mundubat et l’organisation agricole COAG.
Sous le titre, Human Rights and Transnational Corporations in Western Sahara: the case of tomates, il est détaillé comment cinq grands groupes d’entreprises, certains ont participé par Mohamed VI et le Ministre marocain de l’agriculture lui-même, exploitent les terres fertiles dans les territoires occupés du Sahara occidental pour créer l’un des plus grands centres de production de tomates au monde.
L’une des principales entreprises installées est Les Domaine Agricoles. Cette société appartient à la société holding du roi Mohamed VI et produit des tomates et des melons sous la marque « Les Domaines ». Il a été créé à Dakhla en 1989. Les informations relatives à cette société et à l’ensemble de la société holding sont considérées comme strictement confidentielles. Filiale de cette société, le Groupe d’Exportation des Domaines Agricoles (GEDA), est chargée du stockage, du conditionnement et du transport, et entretient un partenariat avec l’entité française Frulexxo, basée à Saint Charles International, Perpignan, qui possède une filiale appelée Eurextra qui commercialise les produits en Espagne.
Il convient également de noter la présence des Domaines Abbes Kabbage (DAK), filiale du groupe Kabbage, dirigée par le maire de l’époque d’Agadir, Tariq Kabbage, qui a pour partenaire dans plusieurs projets l’actuel ministre de la Pêche et de l’Agriculture, Aziz Akhannouch. Comme les autres grands groupes d’entreprises, le DAK dispose de emballeurs de tomates sur le territoire marocain.
Les principales entreprises de Dakhla l’ont déjà fait à Agadir. Ils sont donc des filiales des sociétés mères constituées sur le territoire marocain. En raison d’une exonération fiscale accordée par l’ancien roi du Maroc, Hassan II, au milieu des années 70, les compagnies installées au Sahara occidental sont exonérées du paiement des impôts. Cette exonération fiscale n’a jamais été formalisée dans un texte juridique ou réglementaire.
Irrégularités
L’étude reflète également les nombreuses irrégularités du projet agricole que l’oligarchie marocaine est érigée autour de Dakhla, y compris la violation des droits fondamentaux du peuple sahraoui et la discrimination du travail à l’encontre de cette population, l’usurpation de ses ressources naturelles locales, telles que la terre et l’eau, et la fraude à l’encontre des consommateurs européens dans le domaine de l’étiquetage.
La production agricole au Sahara occidental est concentrée sur un périmètre d’environ 70 km autour de la ville de Dakhla (anciennement Villa Cisneros). Son expansion, basée sur la culture principalement de tomates (environ 80%) et de melon (environ 20%), a commencé dès les premières années de ce siècle, facilitée par un climat favorable de 300 jours d’ensoleillement par an; 30% de plus que dans la région marocaine de Souss Massa, dont la capitale est Agadir, et dans laquelle la grande majorité des tomates sont produites au Maroc – ce qui permet d’anticiper leur culture et leur récolte (en haut de 2 semaines).se positionner plus avantageusement sur les marchés européens. Selon certaines sources, la disponibilité des ressources en eau a été un facteur important dans la mise en place des premières entreprises du secteur, précédemment installées dans la région des Souss, dont les aquifères en déclin ont été largement surexploités.
Au niveau de la main-d’œuvre, on estimait à 14 000 le nombre d’emplois directs dans les unités de production de Dakhla. La grande majorité des salariés sont des Marocains, beaucoup de la région des Sous: ils n’embauchent pas les Sahraouis parce qu’ils se méfient de leur méfiance et parce qu’ils recherchent une main-d’œuvre qualifiée qu’ils trouvent directement dans le Sous, où ils ont déjà accompli ce travail, et où, comme on l’a souligné, ces entreprises sont également installées. Ces données sont conformes à la stratégie de transfert de population et à son intention de convertir la population sahraouie sur le plan démographique. Il y a des déclarations de travailleurs marocains qui dénoncent des conditions de travail déplorables dans les extensions agricoles.
Pas de traçabilité
Le rapport a également un impact sur la traçabilité et les défaillances d’étiquetage identifiées par le COAG au fil des ans: la production de tomates quittant Dakhla, le font par voie terrestre, dans des camions qui les transportent à Agadir, sur le territoire marocain. Là, ils se mêlent au reste de la production de tomates des serres de cette région de Sous, qui encourent déjà dans cette première étape de la chaîne d’exportation dans la zone dite de marrosage du produit, conditionnée et étiquetée comme un produit produit produit au Maroc. L’utilisation de la voie terrestre rend extrêmement difficile le suivi du produit, et il n’existe pas de mécanismes transparents et clairs pour surveiller le produit entre sa sortie des serres et son arrivée dans l’emballage d’Agadir. Il est impossible pour le consommateur européen de discerner l’origine réelle des produits qu’il trouve ensuite dans le secteur, en violation flagrante des règles de l’UE en matière d’étiquetage.
La production agricole au Sahara occidental est concentrée sur un périmètre d’environ 70 km autour de la ville de Dakhla (anciennement Villa Cisneros). Son expansion, basée sur la culture principalement de tomates (environ 80%) et de melon (environ 20%), a commencé dès les premières années de ce siècle, facilitée par un climat favorable de 300 jours d’ensoleillement par an; 30% de plus que dans la région marocaine de Souss Massa, dont la capitale est Agadir, et dans laquelle la grande majorité des tomates sont produites au Maroc – ce qui permet d’anticiper leur culture et leur récolte (en haut de 2 semaines).se positionner plus avantageusement sur les marchés européens. Selon certaines sources, la disponibilité des ressources en eau a été un facteur important dans la mise en place des premières entreprises du secteur, précédemment installées dans la région des Souss, dont les aquifères en déclin ont été largement surexploités.
Au niveau de la main-d’œuvre, on estimait à 14 000 le nombre d’emplois directs dans les unités de production de Dakhla. La grande majorité des salariés sont des Marocains, beaucoup de la région des Sous: ils n’embauchent pas les Sahraouis parce qu’ils se méfient de leur méfiance et parce qu’ils recherchent une main-d’œuvre qualifiée qu’ils trouvent directement dans le Sous, où ils ont déjà accompli ce travail, et où, comme on l’a souligné, ces entreprises sont également installées. Ces données sont conformes à la stratégie de transfert de population et à son intention de convertir la population sahraouie sur le plan démographique. Il y a des déclarations de travailleurs marocains qui dénoncent des conditions de travail déplorables dans les extensions agricoles.
Pas de traçabilité
Le rapport a également un impact sur la traçabilité et les défaillances d’étiquetage identifiées par le COAG au fil des ans: la production de tomates quittant Dakhla, le font par voie terrestre, dans des camions qui les transportent à Agadir, sur le territoire marocain. Là, ils se mêlent au reste de la production de tomates des serres de cette région de Sous, qui encourent déjà dans cette première étape de la chaîne d’exportation dans la zone dite de marrosage du produit, conditionnée et étiquetée comme un produit produit produit au Maroc. L’utilisation de la voie terrestre rend extrêmement difficile le suivi du produit, et il n’existe pas de mécanismes transparents et clairs pour surveiller le produit entre sa sortie des serres et son arrivée dans l’emballage d’Agadir. Il est impossible pour le consommateur européen de discerner l’origine réelle des produits qu’il trouve ensuite dans le secteur, en violation flagrante des règles de l’UE en matière d’étiquetage.
Abus au blanchiment
Le Maroc a poursuivi le Plan Maroc vert dans le cadre du Plan de Génération verte 2030, qui n’a pas dépassé les documents opérationnels, au-delà des grandes lignes présentées par Mohamed VI en février 2020 et de l’intention d’atteindre 5 000 hectares de culture d’ici 2030 dans les zones productives du Sahara occidental. « La crise actuelle causée par les autorités marocaines à la frontière avec l’Espagne s’inscrit dans leur stratégie visant à forcer la communauté internationale à reconnaître sa souveraineté sur les territoires occupés du Sahara occidental et à « blancher » les abus et les illégaux qu’elles commettent depuis des décennies contre les Sahraouis, dans le cas du mégaprojet agricole en question. L’accord de libre-échange signé avec l’UE, les contrôles aux frontières pauvres et la négligence des administrations espagnoles et européennes y ont contribué. Un pays capable d’utiliser ses enfants comme arme de lance pour résoudre ses conflits internationaux n’est pas un « partenaire » fiable et l’UE devrait revoir tous les accords commerciaux avec elle. L’agriculture ne peut continuer à être une monnaie de change. C’est inacceptable », a déclaré Andrés Gongora, responsable des fruits et légumes au COAG lors de la présentation. Le dernier exemple vient du Brexit. Après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, le quota annuel de tomates marocaines aurait dû être réduit en fonction des montants atteignant le marché britannique. Cela n’a pas été le cas et le quota est resté inchangé.
Préjudice pour l’Espagne
L’entrée croissante du Maroc dans l’UE a gravement compromis la production espagnole de tomates. Les calendriers d’exportation du Maroc, traditionnellement dotés d’un accord tarifaire et de contingents, correspondent clairement aux périodes maximales de tomates du sud-est de l’Espagne à son principal marché: le reste des pays de l’UE.
La pression de la consommation de tomates au Maroc n’a cessé de perturber les marchés communautaires en forçant la perte de rentabilité des producteurs européens de tomates. On a clairement mis en évidence la perte continue de superficies survenues dans les principales zones de production à emporter.
À Almeria, la chute de la superficie cultivée de ce légume s’est été de 2 200 hectares en cinq ans, ce qui représente un cinquième de la superficie de la campagne 2015/16.
D’une manière correspondante, les exportations de tomates de cette région ont également été ressenties, compte tenu de l’instabilité et du manque de rentabilité des marchés de destination, avec les dommages évidents à l’économie et à l’emploi dans ces domaines.
#Maroc #Tomates #Agriculteurs #UE #Dakhla #SaharaOccidental