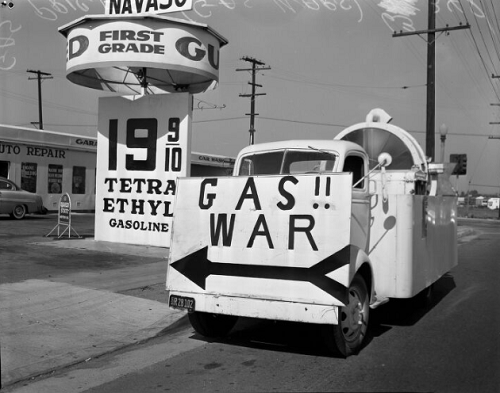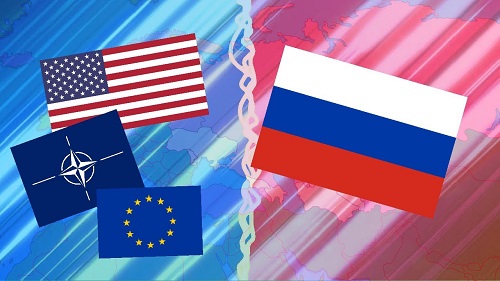Russie, Occident, OTAN, Etats-Unis, Union Européenne, URSS, Union Soviétique, KOSOVO, Géorgie, Ossétie du Sud, Abkhazie, Libye, Syrie,
Introduction
Si aujourd’hui, il est convenu que la crise ukrainienne marque une nouvelle étape dans les relations entre la Russie d’un côté et les Etats unis et l’Union européenne de l’autre, il n’en demeure pas moins que Moscou a constamment cherché à retrouver son prestige de grande puissance internationale. Aujourd’hui, les observateurs internationaux sont unanimes sur fait que Moscou n’est plus disposée à se contenter d’un rôle secondaire sur la scène politique internationale.
D’aucuns aiment à penser qu’il ne s’agit que d’un sursaut d’orgueil national éphémère, car la Russie ne possèderait plus les moyens de ses ambitions. D’autres estiment que, loin d’être un trouble fête, Moscou est en passe de redevenir un véritable poids lourd de la géopolitique avec lequel l’occident devra composer.
De 1991 à 2000:
La Russie se recherche
1. Situation intérieure
L’effondrement de l’URSS s’est accompagné de l’indépendance des 15 républiques qui constituaient l’union. La Russie a hérité de la majeure partie du territoire, de tout l’arsenal nucléaire, d’une grande partie des secteurs industriel et agricole et du siège de la défunte union au sein des instances internationales, y compris celui de membre permanent au Conseil de Sécurité. Mais Moscou a également hérité des passifs financiers et des dettes de l’ex URSS.
Sous Boris Eltsine, le pays a connu une première décennie difficile, marquée par la montée des inégalités et du chômage. La corruption et les mafias se sont généralisées et les problèmes sociaux ont explosé.
Le passage brutal à l’économie de marché, les privatisations massives peu transparentes, les crises politiques à répétition, les guerres médiatiques et une gestion hasardeuse des dépenses ayant conduit au krach boursier de 1998 ont caractérisé cette décennie.
La quasi-débâcle de l’armée russe durant la première guerre de Tchétchénie (1994-1996) n’était pas pour rassurer sur l’image du pays.
2. Relations extérieures
La Russie a tenté, tant bien que mal, de maintenir une présence sur la scène internationale et de donner l’image d’un unificateur. La Communauté des Etats Indépendants (CEI) a été fondée entre la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie avant de s’élargir à huit autres anciennes républiques de l’ex-URSS.
Toutefois, cherchant à arrimer la Russie au système économique mondiale, Boris Eltsine lance alors une stratégie de complaisance vis-à-vis des Etats unis et de l’occident (adhésion à la Banque mondiale et au FMI, coopération avec l’Otan, participation à la FORPRONU en ex-Yougoslavie, signature des accords de réduction des armes chimiques, renonciation à la parité stratégique avec les Etats-Unis, retrait militaire de Cuba etc.)
Le 2ème mandat d’Eltsine commencé en 1996 est marqué par un sentiment de désillusion. Le Ministre des Affaires étrangères de l’époque, Evgueni Primakov était convaincu que la stratégie de complaisance n’apportait pas les résultats escomptés. Commence alors chez les dirigeants russes un repli sur les intérêts nationaux du pays et un rejet de l’unilatéralisme américain.
La décision de l’OTAN d’intervenir militairement au Kosovo plonge les relations avec Washington dans une période de froid.
De 2000 à 2008: La reprise économique et le regain de confiance
L’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000 change complètement la donne. La nomination de plusieurs hauts responsables du KGB et de l’Armée à des postes au Kremlin assure au pays la stabilité politique. Le contrôle étatique dans l’économie se renforce, signe du retour d’un État fort. La croissance économique dépasse est située entre 6 et 8%, les ressources premières du pays, très abondantes, sont mieux utilisées et l’envolée des cours d’énergie permet un désendettement général1 de l’Etat russe et lui permet de diversifier son économie.
En même temps, les motifs de tension entre la Russie et les Etats unis se multiplient. La prolongation de la présence militaire américaine en Asie centrale et le soutien actif aux révolutions en Ukraine et en Géorgie, avec l’arrivée au pouvoir de Tymochenko et Saakachvili, tous deux partisans d’un rapprochement avec l’occident, et de l’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN renforcent le sentiment à Moscou que Washington cherche à isoler la Russie.
Ajouté à cela, les critiques américaines sur les questions de démocratie et droits de l’Homme en Russie, la reconnaissance par les Etats-Unis de l’indépendance du Kosovo, l’abrogation du traité ABM de 1972, l’envahissement unilatéral de l’Irak, l’installation de bases américaines en Roumanie et en Bulgarie, ou encore du projet d’installation d’éléments du système de défense anti-missile américain en Pologne2 et en République tchèque.
Dans un discours prononcé à Munich, le 10 février 2007, Vladimir Poutine critique fortement l’«unilatéralisme américain », dénonce la volonté des Etats-Unis de construire de nouvelles démarcations en Europe et plaide pour un monde multipolaire.
De 2008 à aujourd’hui : Le retour d’une puissance mondiale
En janvier 2008, et au terme de deux mandats, Vladimir Poutine «confie» provisoirement la présidence à son homme de confiance, Dimitri Medvedev.
Moins de deux mois plus tard, la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo constitue un tournant dans la politique étrangère de la Russie, dont le nouveau président énonce les 5 principes :
a. La «primauté» du droit international ;
b. La «multipolarité» du monde ;
c. Le désir «d’éviter les conflits et l’isolement» ;
d. La «défense de la vie et de la dignité des citoyens russes où qu’ils se trouvent ; protection des entrepreneurs à l’étranger» ;
e. La reconnaissance par la Russie de «zones d’intérêts privilégiés».
Ces principes consacrent et scellent la divergence avec la conception américaine de la géopolitique mondiale et jettent les fondements d’un retour avéré de la Russie comme grande puissance mondiale.
1. Indépendance du Kosovo
L’opposition à l’indépendance du Kosovo a permis à la Russie de renforcer son influence sur la scène des Balkans occidentaux, et notamment auprès de la Serbie.
Pour Moscou, cette indépendance viole l’intégrité territoriale de la Serbie et constitue une révision dangereuse des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale.
La présence de fortes minorités albanaises en Macédoine et au Monténégro pourraient suivre l’exemple du Kosovo, ce qui risque de déstabiliser toute la région. Plus encore, Moscou évoque l’impact de ce précédent sur les « conflits gelés » notamment, la Transnistrie en Moldavie, ou l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud en Géorgie.
2. La Géorgie, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie
Soutenue par les Etats unis et l’Union européenne, le Président géorgien, Saakashvili entendait suivre l’exemple des républiques baltes et rejoindre l’UE et l’OTAN. Pour la Moscou, il était hors de question que ces institutions, fondées durant la guerre froide, ne s’installent au Caucase. Par ailleurs, la Géorgie et ses infrastructures étaient trop importantes dans l’équation géopolitique énergétique russe, notamment pour l’acheminement vers l’Europe du pétrole et gaz de la mer caspienne.
Moscou ne pouvait donc pas trouver meilleure opportunité que la Géorgie pour réaffirmer sa puissance recréée. En effet, la Russie a défié l’OTAN en toute impunité et la Géorgie, qui comptait sur un soutien ferme de l’Occident, s’est retrouvée seule face aux troupes russes. Le message était désormais clair : dans la sphère d’influence de la Russie, s’allier à Washington ne peut garantir la sécurité.
3. La question du nucléaire iranien
L’Iran est un partenaire traditionnel et un voisin de la Russie. Les relations commerciales sont étroites et le volume des échanges ne cesse d’augmenter. Concernant le dossier nucléaire iranien, la position de la Russie peut être résumée ainsi :
L’Iran a le droit à l’utilisation pacifique de l’énergie atomique
La Russie continue à coopérer avec l’Iran dans le développement de son secteur de l’énergie nucléaire.
La Russie est résolument opposée à toute possibilité d’une dimension militaire du programme nucléaire iranien.
La Russie est convaincue qu’il n’y a pas d’alternative à une solution diplomatique négociée (donnant/donnant) ; soit un compromis.
Moscou est en faveur de la présence des experts et observateurs de l’AIEA, même si, jusque là, ils n’ont trouvé aucune preuve d’activités nucléaires illégales.
La Russie souligne l’importance de la reprise des négociations 5+1.
La Russie soutient l’approche progressive où à chaque étape où Téhéran répond aux attentes de l’AIEA et de l’ONU, les sanctions doivent être atténuées.
La Russie est contre toute tentative unilatérale hors du Conseil de sécurité des Nations Unies
Il n’y a pas de solution militaire au problème.
En 2010, la Russie a difficilement accepté de voter en faveur de la Résolution 1929 imposant plus de sanctions à l’encontre de l’Iran. En effet, Moscou s’est vue obligée d’annuler une importante commande de missiles S-300, ce qui a jeté un coup de froid sur ses relations avec Téhéran.
Avec la crise ukrainienne en toile de fonds, les avis divergent sur l’avenir de la position russe concernant ce dossier. Pour certains, il y a au moins trois raisons pour que la Russie continue à coopérer avec l’occident sur le dossier nucléaire iranien:
La Russie, tout comme les Etats unis, s’oppose à ce que l’Iran se dote de l’arme nucléaire.
Le retrait de Moscou ouvrirait la voie à d’autres alternatives au processus diplomatique.
Les relations économiques entre la Russie et l’Iran sont trop modestes et ne constituent pas un enjeu majeur pour la Russie.
4. L’intervention internationale en Libye
La Russie s’était abstenue lors du vote au Conseil de Sécurité pour imposer une zone d’exclusion aérienne en Libye, ce qui a permis à la résolution de passer. L’intervention militaire aérienne, deux jours plus tard, a créé un profond sentiment d’amertume chez les responsables russes pour qui, la Résolution n’autorise pas les frappes contre la Libye. Une polémique a même éclaté publiquement entre le président Dmitri Medvedev et le Premier ministre Vladimir Poutine.
Désormais pour Moscou, la confiance n’est plus de mise.
5. Le dossier syrien
Depuis son indépendance, la Syrie a entretenu des relations étroites avec Moscou (l’URSS et plus tard, la Russie) qui est son premier fournisseur d’armes. Les exportations russes vers la Syrie dépassent le milliard de dollars et les investissements russes y sont estimés à 19 milliards de dollars.
L’importance stratégique de la Syrie réside dans le fait qu’elle accueille la seule base navale russe en Méditerranée dans la ville de Tartous. Sur fond de détérioration des ses relations avec l’occident, depuis la guerre d’Ossétie du Sud en 2008, la Russie a décidé de renforcer sa présence en Méditerranée et obtient, contre l’annulation d’une partie de la dette syrienne, l’accord de Damas pour le développement et l’agrandissement de la base navale de Tartous, ce qu’elle entame depuis 2009.
Par ailleurs, l’expérience libyenne a contribué à un raidissement de la position de la Russie devenue intransigeante sur le dossier syrien.
En octobre 2011 et en février 2012, la Russie et la Chine opposent leur veto à deux reprises pour s’opposer à deux projets de Résolution du Conseil sécurité sur la Syrie.
Ce « manque de flexibilité » de la part de Moscou conduit la communauté internationale à un sentiment d’impuissance. En effet, les Etats unis et l’UE sont incapables de déloger le régime Assad.
6. La crise ukrainienne
Tout comme dans le cas de la Géorgie, l’Ukraine s’est trop rapprochée de l’UE et de l’Otan. Or de tous les pays de la sphère d’influence de la Russie, l’Ukraine est de loin la plus importante. Elle abrite la base navale de Sébastopol (Crimée). Elle est une voie de transit hautement importante pour le gaz russe vers l’Europe occidentale, un grenier de blé en Europe. Une grande partie de sa population est russophone. L’Est et le Sud de l’Ukraine (partie la plus riche avec l’industrie et l’agriculture) sont largement acquis à la Russie.
En conséquence, Moscou s’est vue obligée d’agir « par procuration » pour défendre ses intérêts et éviter une occidentalisation de l’Ukraine.
Comble de cela, Moscou n’a pas eu recours à son armée pour redresser la situation, à l’exception de la Crimée où elle était de toutes les manières stationnée.
L’Occident est en passe de comprendre qu’il ne peut gagner cette confrontation car la Russie ne peut pas la perdre.
À ce stade, les options de Washington et de Bruxelles sont plutôt limitées. Ils ne peuvent pas affronter militairement la Russie, tandis que les sanctions économiques ne fonctionnent pas et que l’Europe, dont l’économie est convalescente, a besoin de pétrole et de gaz russes.
En signant avec la Pékin «le contrat du siècle» d’une valeur de 400 milliards de dollars pour la livraison à la Chine de gaz naturel sur 30 ans, le président Poutine a réalisé ce que les dirigeants de l’Ouest craignaient: un pivot vers l’Extrême-Orient qui rend la Russie beaucoup moins vulnérable à toute éventuelle sanction de la part de Bruxelles.
7. Autres éléments de puissance
L’armée russe est une des plus puissantes au monde. Moscou a hérité de la totalité de l’arsenal de l’URSS.
La Russie est le plus grand producteur de gaz naturel au monde. Elle en est également le plus grand fournisseur de l’Europe. Elle a su développer cet atout et le transformer en véritable levier géopolitique.
Le Russie est très active dans le cadre de deux alliances militaires régionales destinées, entre autres à garder les États-Unis et l’OTAN loin de la région: l’Organisation de Coopération de Shanghai3 (OCS) et l’Organisation du Traité de Sécurité Collective4 (OTSC).
Source : Document confidentiel de la diplomatie marocaine
#Russie #OTAN #Occident #URSS #Libye #Syrie #Kosovo #Serbie #Ukraine