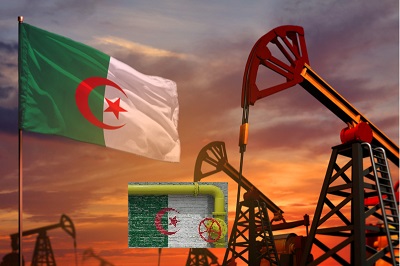Russie, Ukraine, OTAN, Occident, Donbass, nationalisme, Transnistrie, Crimée, Union Européenne, UE,
Donbass et au-delà : l’autodétermination invoquée par la Russie n’a pas apporté de droits
Parmi les diverses raisons invoquées par le Kremlin pour justifier la soi-disant « opération militaire spéciale » en Ukraine, le prétendu soutien à l’autodétermination des peuples est particulièrement évocateur et donc favorable à la propagande russe.
D’autre part, il n’est pas difficile de tomber dans le piège de la communication où la Russie se bat pour une fin noble et altruiste, en subissant des pertes très élevées dans ses rangs pour que d’autres puissent se libérer de la domination de Kiev et choisir librement leur propre système de gouvernement.
Admettons ou non que l’on puisse parler d’un peuple à part entière dans le contexte du Donbass oriental ou de la Crimée, qu’est-ce que cela veut dire et, surtout, comment se traduit concrètement l’autodétermination des peuples souvent invoquée par Moscou ?
Dans le Donbass, les droits civiques n’ont connu aucune amélioration
Pour comprendre la signification juridique et politique complexe de ce principe, il faut remonter à la seconde période d’après-guerre et au début du processus de décolonisation, c’est-à-dire le processus qui a permis à presque toutes les possessions coloniales d’accéder à l’indépendance nationale.
Dans ce contexte historique, les dirigeants des mouvements de libération nationale ont réadapté le principe d’autodétermination des peuples, en en faisant un incontournable de leur communication politique. Ils ont alors commencé à présenter ce principe comme un droit humain fondamental et collectif , c’est-à-dire comme une condition nécessaire et préalable à la jouissance des libertés individuelles consacrées par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme.
L’argument est immédiatement convaincant : à quoi bon parler des droits de l’homme au niveau individuel quand la communauté ne peut pas décider de son destin ?
De 1945, année de la fondation des Nations Unies, à 1975, année du démantèlement définitif de l’empire portugais, le nombre d’États reconnus comme indépendants et donc admis dans ladite organisation est passé de 51 à l’origine à 144 ; à la fin du siècle, le total était encore passé à 189.
Ce qui se passe aujourd’hui dans l’est du Donbass et en Crimée n’entre certainement pas dans le cadre historique ou géographique du processus de décolonisation , mais la prétendue relation causale entre l’indépendance de l’État et la pleine jouissance des droits de l’homme au niveau individuel reste d’une actualité brûlante et inchangée. intérêt académique. . En termes simples, un Donbass indépendant serait-il le signe avant-coureur de plus de libertés et de droits pour ceux qui y vivent ? En ce qui concerne la Crimée, y a-t-il eu des améliorations socio-juridiques depuis son rattachement à la Fédération de Russie, rien du point de vue du droit international mais néanmoins présenté comme l’expression de la volonté populaire ?
Pour tenter de répondre à ces questions, cette contribution s’appuie sur les données publiées par Freedom House et relatives à la période quinquennale 2017-2021.
Avant de procéder à l’analyse des données, il convient de mentionner que, bien qu’autorisée et forte de 80 ans d’expérience, Freedom House est largement financée par le gouvernement fédéral américain. Bien qu’il existe des alternatives valables au score Freedom House Global Freedom (pensez, par exemple, à l’Economist Democracy Index), seul celui-ci considère les territoires de facto indépendants et ceux sous occupation étrangère de manière autonome par rapport au pays auquel ils appartiennent formellement. Une telle analyse permet d’appréhender d’éventuels changements, pour le meilleur ou pour le pire, à moyen terme. La note attribuée annuellement par Freedom House concerne exclusivement les droits civils et politiques et est exprimée en centièmes ; plus le score est élevé, meilleure est la situation dans ce pays ou territoire.
Compte tenu de ce qui précède, le mauvais score de 4/100 révèle à quel point la situation dans l’est du Donbass est non seulement dramatique, mais également stable au cours de la période sous revue.
L’absence quasi totale de droits s’explique en grande partie par la persistance de l’état de guerre civile qui touche depuis 2014 les provinces sécessionnistes de Donetsk et de Lougansk, auquel se réfère le score. À titre de comparaison, Freedom House a attribué des scores similaires à d’autres pays ou territoires où sévissent un conflit armé ou une violence politique généralisée, de la Syrie au Soudan du Sud, de la République centrafricaine au Sahara occidental.
Limitation des droits de vote et absence de garanties légales
Admettons donc les circonstances atténuantes, voyons maintenant ce qui se passe dans les territoires sous le contrôle des forces séparatistes de Donetsk et Lougansk. Selon Freedom House, il n’y a pas d’élections libres dans l’est du Donbass, ni d’autorités électorales indépendantes pouvant certifier leur régularité . Pour ceux qui décident tout de même d’aller aux urnes, le choix est réduit au minimum, avec seulement deux partis autorisés par province. Même choisir pour qui voter n’est pas facile, étant donné que le programme électoral des partis est presque identique et résolument pro-russe.
Les restrictions au droit de vote ne sont pas un cas isolé dans l’est du Donbass. Les constitutions des républiques sécessionnistes garantissent formellement l’égalité des droits indépendamment de l’ethnicité, de la race ou des croyances religieuses, mais dans la pratique, les groupes ethniques et religieux non affiliés à la Russie sont exclus de la vie politique .
Aucune frange de la société n’est donnée pour s’organiser de manière indépendante pour défendre ses intérêts dans la sphère politique. La liberté d’expression est également sévèrement limitée ; exprimer des sympathies pro-ukrainiennes est même considéré comme dangereux pour ceux qui lui donnent une voix. La télévision et la radio sont sous le contrôle strict des autorités provinciales ; Les journalistes et les blogueurs qui critiquent les dirigeants séparatistes essaient d’opérer le plus possible dans l’anonymat, sachant que leur identification serait suivie d’une arrestation et d’une détention.
En ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement provincial, la situation n’est pas meilleure. Il n’y a aucune transparence dans le processus décisionnel , ni aucune garantie légale contre les abus fréquents perpétrés par des policiers ou des membres de l’appareil de sécurité.
Depuis 2014, de nombreux résidents identifiés comme Ukrainiens sont partis, souvent sous la menace ou la contrainte. Pour ceux qui ont choisi de rester, la vie devient chaque jour plus difficile : les deux provinces ont imposé le russe comme seule langue officielle . L’inexorable processus de russification a également affecté le secteur de l’éducation, où les programmes scolaires et universitaires ont été progressivement alignés sur ceux en vigueur dans la Fédération de Russie.
Qui contrôle vraiment les territoires, c’est la Russie
Si le présent est sombre, l’avenir n’augure rien de bon. Au cours des huit dernières années, la Russie a d’abord établi et accru son contrôle sur tous les aspects de la vie quotidienne dans l’est du Donbass , y compris les affaires politiques. Les citoyens russes occupent des postes clés au sein de l’administration publique, des grandes activités commerciales, des télécommunications et du système éducatif.
Cependant , le principal instrument du pouvoir russe dans le Donbass reste le ministère de la Sécurité d’État , qui, selon Freedom House, est directement contrôlé par le Service fédéral de sécurité russe (également connu sous le nom de FSB).
On pense également que des officiers réguliers de l’armée russe commandent les soi-disant « milices populaires » de l’est du Donbass , fortes de dizaines de milliers d’hommes.
Cela dit, pourquoi la pénétration russe dans les structures politiques et militaires et le tissu économique des provinces séparatistes représente-t-elle un grave problème tant pour les perspectives de paix en Ukraine que pour les espoirs de plus grands droits pour ceux qui y vivent dans le Donbass ? La réponse est facile à comprendre : la présence russe massive et enracinée limitera davantage l’espace de manœuvre militaire, politique et économique des provinces séparatistes, les condamnant à une dépendance toujours plus grande vis-à-vis de Moscou .
Pas de nouvelle liberté pas même en Transnistrie et en Crimée
À ce stade, il est légitime de se demander si le Donbass oriental est un cas à part ou s’il reflète la tendance générale de tous les territoires contrôlés par les forces séparatistes pro-russes ( comme l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud et la Transnistrie) ou occupés en permanence par les Russes. (par exemple la Crimée ). Les scores de Freedom House pour ces territoires nous permettent de tirer quelques conclusions préliminaires.
En premier lieu, l’autonomie obtenue par les militaires de ces territoires n’est pas une condition suffisante pour l’amélioration progressive des libertés fondamentales et des droits civils de ceux qui y résident. C’est certainement le cas de la Transnistrie, région de Moldavie mais de fait autonome depuis 1992, dont le score, déjà bas dès le départ, a chuté de six points ces cinq dernières années, atteignant les 18/100 actuels.
Même l’Abkhazie, qui malgré le score le plus élevé parmi tous les territoires susmentionnés (40/100), n’a enregistré aucune amélioration au cours des cinq dernières années, perdant en fait un point de pourcentage.
Deuxièmement, les territoires autonomes de facto obtiennent des scores nettement inférieurs à ceux des États souverains auxquels ils appartiennent formellement (Géorgie 58/100 ; Moldavie 62/100 ; Ukraine 61/100).
Troisièmement et enfin, l’annexion à la Fédération de Russie, même là où elle représente la volonté populaire, ne s’est pas traduite par de plus grandes libertés pour les « nouveaux Russes ».
Comme preuve de ce qui a été écrit, pensez à la situation tragique des Tartares, reconnus comme une population indigène de la Crimée soviétique il y a exactement un siècle et depuis 2014 à nouveau l’objet de persécutions systématiques. Sur les quelque 100 000 personnes qui ont quitté la Crimée depuis l’annexion de 2014, environ la moitié appartiennent à la minorité tatare. [1] Cela est vrai tant pour les territoires déjà formellement annexés (Crimée 7/100) que pour ceux qui y aspirent (Ossétie du Sud 11/100), dont les citoyens doivent endurer des limitations de liberté encore plus importantes que les vrais Russes. (19/100).
Tout en reconnaissant que l’indépendance convoitée (avec la reconnaissance internationale qui en découle) est une condition différente et plus précieuse que l’autonomie dont jouissent actuellement ces territoires, il n’existe cependant aucune preuve empirique pour étayer l’argument selon lequel l’autodétermination des peuples précède et crée la conditions d’une transition démocratique et de droits accrus.
Marco Bocchese
Institut Italien d’Etudes Politiques Internationales, 16 mai 2022
Au-delà de la « fin de l’histoire » : Nationalisme, libéralisme et la guerre en Ukraine
par Hadas Aron et Emily Holland
Hadas Aron est professeur assistant invité au Centre d’études européennes et méditerranéennes de l’Université de New York. Elle est spécialisée dans le populisme, le nationalisme, la démocratie et la politique européenne. Emily Holland est professeur assistant à l’Institut d’études maritimes russes de l’US Naval War College, spécialisée dans la politique étrangère russe, la géopolitique de l’énergie et la politique européenne.
Lors d’un récent discours nocturne au peuple ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a proclamé que Kiev était désormais « la capitale de la démocratie mondiale, la capitale de la lutte pour la liberté de tous sur le continent européen ».1 Zelensky a été un puissant communicateur tout au long de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Zelensky a été un puissant communicateur tout au long de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Ses discours dressent un tableau saisissant : les ténèbres de la dictature russe marchant sur l’Ukraine pour éteindre le phare de la démocratie libérale.
Le monde observe l’alliance du libéralisme et du nationalisme dans la lutte de l’Ukraine pour sa survie. Ces deux idées étaient l’idéologie déterminante des luttes fondatrices 1 Présidence ukrainienne, Kyiv est maintenant la capitale de la démocratie mondiale, la capitale de la lutte pour la liberté pour tous en Europe – Discours du président Volodymyr Zelenskyy, 6 avril 2022, . pour la libération de la tyrannie comme la Révolution française et les révolutions de 1989. Pourtant, le nationalisme et le libéralisme comportent des éléments contradictoires qui apparaissent une fois les moments de crise passés. Après les révolutions de 1989, l’Occident, ivre du triomphe du libéralisme, a mal compris la centralité du nationalisme et a mis en œuvre des politiques qui ont finalement renforcé le nationalisme d’exclusion et affaibli le libéralisme.
Le nationalisme, la lutte pour la souveraineté et l’autodétermination, n’est pas souvent associé au libéralisme, la philosophie politique qui met l’accent sur la protection des droits individuels. Ces dernières années en particulier, le nationalisme en est venu à signifier un nativisme d’exclusion. Des mouvements comme les Proud Boys et les Oath Keepers sont tout sauf libéraux : ce sont des suprémacistes blancs qui tentent de saper la démocratie libérale mondiale. Historiquement, cependant, le libéralisme et le nationalisme étaient du même côté à certains moments cruciaux de l’histoire.
Comme l’histoire le démontre, ces forces s’alignent lorsqu’elles ont un ennemi commun, la tyrannie, mais deviennent souvent contradictoires une fois la lutte de libération achevée. En Europe, jusqu’aux révolutions de 1848, les nationalistes comme Lafayette, Garibaldi et Mazzini étaient des libéraux. Ils cherchaient à unir leurs nations sous des constitutions qui garantiraient les droits individuels. Mais la révolution libérale a échoué et après la restauration des monarchies en 1849, les objectifs des libéraux et des nationalistes ont divergé.
Les libéraux cherchent à préserver leurs nouveaux droits constitutionnels, tandis que les nationalistes continuent à lutter pour l’unité nationale, mais sous une forme exclusive et conservatrice. En Allemagne, au lieu d’aligner les germanophones sur un ensemble d’idéaux civiques libéraux, l’État prussien militant a uni les Allemands par la guerre et l’expansion. En France, les républicains recherchent les droits démocratiques et l’égalité socio-économique, tandis que les nationalistes veulent redonner à la France sa gloire monarchique. Ces deux forces sont devenues le clivage déterminant du système politique français au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
En 1989, les peuples d’Europe centrale et orientale sont descendus dans la rue pour réclamer leur libération de l’oppression soviétique, abattant physiquement les murs qui séparaient l’Est de l’Ouest. Parmi eux se trouvait un jeune homme de 26 ans aux cheveux longs, Viktor Orbán, le controversé premier ministre hongrois, qui était l’incarnation de la combinaison du libéralisme et du nationalisme. Dans un discours célèbre, il a proclamé que les jeunes se battaient « pour l’établissement d’une démocratie libérale en Hongrie ».2
Pourtant, dès le début des années 1990, Orbán, alors député et chef du parti Fidesz, a pris un virage à droite et mis l’accent sur le nationalisme. Ces dernières décennies, il est devenu un ennemi du libéralisme, réécrivant la constitution hongroise, démantelant les tribunaux et limitant les médias indépendants et la société civile.3 Aujourd’hui, la Hongrie n’est plus considérée comme une démocratie.4
En Pologne, le mouvement libéral nationaliste Solidarité, mouvement emblématique de 1989, s’est scindé en factions libérales et nationalistes directement après la transition, et celles-ci restent enfermées dans une lutte existentielle pour l’avenir de la Pologne5 .
En Pologne comme en Hongrie, une profonde animosité entre libéraux et nationalistes a conduit à une attaque nationaliste contre la démocratie libérale et à un inquiétant déclin démocratique dans les deux cas les plus prometteurs de démocratisation post-soviétique.
La dernière décennie a en effet vu une montée du nationalisme dans le monde entier, un revers surprenant pour le libéralisme. Le nombre de personnes vivant dans des démocraties libérales n’a jamais été aussi bas depuis 19897, effaçant pour l’essentiel les avancées réalisées depuis la fin de la guerre froide. Mais le nationalisme n’est pas réapparu comme par enchantement : un examen historique attentif révèle l’existence de thèmes nationalistes forts dans la lutte pour se libérer du régime communiste. Dans ce moment libéral triomphant, l’Occident a considéré le nationalisme comme une idéologie révolue qui n’influencerait plus les résultats politiques.
La fin de l’histoire ?
L’ouvrage de Francis Fukuyama intitulé « La fin de l’histoire » traduit bien le sentiment de victoire de l’après-1989. Selon Fukuyama, le libéralisme avait finalement triomphé de toutes les idéologies politiques alternatives – le communisme, le fascisme et le nationalisme devaient tous être relégués dans les poubelles de l’histoire.8 Bien que Fukuyama ait mis en garde contre les dangers du populisme et la montée de la violence ethnique et nationaliste, son argument central est devenu le credo de l’après-guerre froide, et les décideurs politiques s’y sont appuyés pour concevoir l’architecture d’un « nouvel ordre mondial ».
L’implication politique la plus importante du triomphe du libéralisme a été la conviction que l’Occident peut et doit exporter la démocratie au profit de l’humanité. La promotion de la démocratie est devenue un parapluie pour toute une série de politiques, y compris les réformes économiques dans les pays étrangers, la conception d’institutions politiques, l’investissement dans la société civile et même l’expansion de l’OTAN9 .
Mais la promesse de la fin de l’histoire ne s’est pas concrétisée. En moins d’une décennie, la Yougoslavie a éclaté en une série de guerres nationalistes sanglantes, et la promesse naissante de la démocratie russe s’est effondrée dans le chaos et l’instabilité. Le programme de promotion de la démocratie n’était pas adapté à l’histoire et aux contextes sociaux particuliers des pays qu’il visait. En conséquence, même dans les pays qui évoluaient déjà vers la démocratie, comme la Hongrie et la Pologne, cette intervention descendante dans la politique intérieure a déclenché une réaction brutale contre le libéralisme, qui a éclaté après la crise financière de 2008. Les électeurs ont rendu les libéraux, qu’ils associaient aux réformes néolibérales mondiales, responsables de leurs difficultés.
L’administration Clinton s’est faite la championne des réformes économiques à taille unique qui, dans certains endroits, ont échoué presque immédiatement. Dans de nombreux États postcommunistes, la première série de réformes, la privatisation, a été mise en œuvre rapidement, mais les réformes réglementaires nécessaires ont tardé. Cela a incité les acteurs corrompus à s’emparer des services et à bénéficier d’une réforme partielle.10 L’effondrement de la monnaie russe à deux reprises dans les années 1990 a suivi cette tendance, favorisant finalement l’ascension de Vladimir Poutine en tant que sauveur de la nation des douleurs et de l’instabilité du libéralisme.11 Cela s’est également produit en Ukraine dans les années 1990, créant une classe puissante d’oligarques qui ont pillé l’État et bloqué les réformes ultérieures.12
Les efforts de lutte contre la corruption ont eu des résultats mitigés et se poursuivent. Les acteurs occidentaux ont également profité de la corruption ukrainienne de diverses manières.13 Paul Manafort est l’exemple honteux d’un acteur politique qui a défendu les intérêts des oligarques ukrainiens pro-russes pour son profit personnel.14 Plus généralement, la corruption généralisée et l’exploitation mercenaire ont soutenu l’affirmation nationaliste selon laquelle le libéralisme occidental était une façade hypocrite pour des intérêts économiques. Bien plus prometteuse que les efforts de réforme extérieurs est la pression croissante des citoyens ukrainiens qui en ont assez d’un système corrompu, ce qui s’est traduit par un changement politique15 .
Pour les personnes qui ont connu le communisme, la confiance dans les institutions de l’État était presque inexistante. Après la transition, il n’y a pas eu de tentative majeure de convaincre les citoyens que le libéralisme était un système de valeurs important. Au lieu de cela, l’imposition rapide d’institutions fortement libérales, telles que de puissantes cours constitutionnelles, n’a pas laissé de place au développement des normes de l’État de droit et a finalement déclenché une réaction brutale. En Ukraine, la cour constitutionnelle est déjà considérée comme un acteur politique16, mais pas nécessairement comme un acteur libéral. L’Ukraine devrait faire preuve de retenue judiciaire et comprendre les limites des tribunaux dans les sociétés en voie de libéralisation.
L’adhésion à l’UE est le Saint Graal pour les pays en voie de démocratisation. Les appels fréquents de l’Ukraine pour une adhésion accélérée pendant une guerre meurtrière montrent que les avantages culturels et économiques de l’adhésion restent une priorité absolue pour les pays candidats. Les Européens centraux et orientaux ont observé avec envie leurs voisins occidentaux s’enrichir et prospérer après la Seconde Guerre mondiale.
Pour les élites politiques d’Europe centrale et orientale, la perspective d’adhérer à l’UE était si attrayante qu’il n’y avait pas de débat politique sur l’orientation des réformes requises. Cela signifie souvent une transformation fondamentale de la structure de l’État. Lorsque l’adhésion à l’UE n’a pas tenu ses promesses irréalistes, les libéraux nationaux ont été accusés de sacrifier l’intérêt national à leur propre intérêt. Ils sont devenus les agents nationaux d’un processus étranger avilissant.
Nationalisme et libéralisme en Ukraine
Depuis 1991, la politique ukrainienne est profondément polarisée, chaotique, marquée par une corruption endémique et son développement est entravé par la pénétration d’intérêts pro-russes. En conséquence, le système politique ukrainien a été paralysé, ce qui a conduit à l’indignation et à deux révolutions populaires en 2005 et 2014.
Pourtant, comme l’a théorisé le sociologue Charles Tilly, les États sont consolidés par la guerre.17 Depuis la révolution de Maidan et l’annexion de la Crimée en 2014, l’Ukraine connaît un processus de changement.18 Pour les Ukrainiens, le sentiment d’une identité nationale unifiée s’est renforcé. La guerre actuelle ne peut que solidifier davantage l’identité nationale ukrainienne qui est composée d’éléments nationalistes et libéraux, car le nationalisme ukrainien s’oppose par nature à l’impérialisme russe illibéral.
L’alignement des forces nationalistes et libérales s’est également produit en Europe centrale et orientale à la fin des années 1980, car l’identité nationale de la région s’opposait à l’oppression soviétique illibérale. Cependant, une fois que la menace d’une invasion russe a diminué, les deux forces se sont déchirées. Tant qu’il existe une menace russe importante contre l’Ukraine, le nationalisme peut continuer à être une force libérale. Il faut espérer que le conflit actuel sera bientôt résolu, mais cela n’effacera guère la réalité géographique et stratégique que constitue le fait d’avoir la Russie comme voisin immédiat. Quoi qu’il en soit, l’histoire démontre que rien ne garantit que le nationalisme restera libéral.
After the conflict, Ukraine will need significant reconstruction, but it is crucial that this process give space and autonomy for Ukraine to internally resolve the tension between nationalism and liberalism. For the West it is important to support the demand for liberalism in Ukraine – liberalism is a tenet of the Western way of life and its most important discursive tool in its competition with China. At the same time, it is important to avoid outcomes like contemporary Hungary and Poland, where liberalism has lost ground to illiberal exclusionary nationalism. Ukraine has been mired in trouble since independence, but prior to WWII many Western European countries were non-democratic, and in some cases fascist. Ukraine’s history and future development should not be treated as deterministic.
25 May 2022
Notes :
1 Ukrainian Presidency, Kyiv Is Now the Capital of Global Democracy, the Capital of the Struggle for Freedom for All in Europe – Address by President Volodymyr Zelenskyy, 6 April 2022, https://www.president.gov.ua/en/news/zarazkiyiv-ce-stolicya-globalnoyi-demokratiyistolicya-boro-74129.
2 For a translation of the speech see: “Fill in the Blanks”, in The Orange Files, 20 June 2013, https://wp.me/p3vCr9-5i.
3 Human Rights Watch, Wrong Direction on Rights. Assessing the Impact of Hungary’s New Constitution and Laws, 16 May 2013, https:// www.hrw.org/report/2013/05/16/wrongdirection-rights/assessing-impact-hungarysnew-constitution-and-laws; Patrick Kingsley, “After Viktor Orban’s Victory, Hungary’s Judges Start to Tumble”, in The New York Times, 1 May 2018, https://www.nytimes.com/2018/05/01/ world/europe/hungary-viktor-orban-judges. html; Krisztián Simon and Tibor Rácz, “Hostile Takeover: How Orbán Is Subjugating the Media in Hungary”, in Heinrich-Böll-Stiftung Articles, 22 August 2017, https://www.boell.de/en/ node/62129.
4 Freedom House, “Hungary”, in Nations in Transit 2020, https://freedomhouse.org/ node/3458.
5 Krzysztof Jasiewicz, “From Solidarity to Fragmentation”, in Journal of Democracy, Vol. 3, No. 2 (April 1992), p. 55-69.
6 “EU Fines Poland €1 Million per Day over Judicial Reforms”, in Deutsche Welle, 27 October 2021, https://p.dw.com/p/42DrB. 7 Vanessa A. Boese et al., Autocratization Changing Nature? Democracy Report 2022, Gothenburg, V-Dem Institute, March 2022, https://v-dem.net/media/publications/dr_2022. pdf.
8 Francis Fukuyama, “The End of History?”, in The National Interest, No. 16 (Summer 1989), p. 3-18. 9 Michael Mandelbaum, “Preserving the New Peace. The Case against NATO Expansion”, in Foreign Affairs, Vol. 74, No. 3 (May-June 1995), p. 9-13.
10 Joel S. Hellman, “Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions”, in World Politics, Vol. 50, No. 2 (January 1998), p. 203-234.
11 Kristy Ironside, “The Ruble Has Plummeted. It’s Not the First Time”, in The Washington Post, 28 February 2022, https://www. washingtonpost.com/outlook/2022/02/28/ ruble-has-plummeted-its-not-first-time.
12 Serhiy Verlanov, “Taming Ukraine’s Oligarchs”, in UkraineAlert, 19 November 2020, https://www.atlanticcouncil.org/?p=322616.
13 OECD Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central Asia, Anti-Corruption Reforms in Ukraine: Prevention and Prosecution of Corruption in State-Owned Enterprises. 4th Round of Monitoring of the Istanbul AntiCorruption Action Plan, Paris, OECD, 4 July 2018, https://www.oecd.org/corruption/anticorruption-reforms-in-ukraine.htm.
14 Ilya Marritz, “Let’s Recall What Paul Manafort and Rudy Giuliani Were Doing in Ukraine”, in ProPublica, 1 March 2022, https://www. propublica.org/article/lets-recall-what-exactlypaul-manafort-and-rudy-giuliani-were-doingin-ukraine.
15 Steven Pifer, “Ukraine: Six Years after the Maidan”, in Order from Chaos, 21 February 2020, https://brook.gs/3bXkGmx.
16 Alina Cherviastova, “False Dilemma”, in Verfassungsblog, 21 February 2021, https:// verfassungsblog.de/false-dilemma.
17 Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992, Cambridge, Basil Blackwell, 1990.
18 Sofiya Kominko, “Ukraine’s Nation-Building Journey and the Legacy of the Euromaidan Revolution”, in UkraineAlert, 20 April 2021, https://www.atlanticcouncil.org/?p=380204.
Source : Istituto Affari Internazionali