Tags : Sahara Occidental, Maroc, Front Polisario – RFI : Le conflit oublié du Sahara occidental
Depuis un an, les indépendantistes sahraouis du front Polisario ont repris leurs opérations militaires contre l’armée marocaine, après quasiment trois décennies de cessez-le-feu. Un conflit asymétrique dont ils espèrent qu’il relancera les négociations autour de ce territoire au statut contesté, au cœur de la tension diplomatique entre le Maroc et l’Algérie.
De notre envoyé spécial dans les camps de réfugiés sahraouis et dans les territoires contrôlés par la République arabe sahraouie démocratique,
À 6 km en face de nous s’élèvent des panaches de fumée. Allongés au sommet d’une dune de sable et de petits cailloux noirs rendus brûlants par le soleil, nous observons en compagnie de combattants de l’armée populaire de libération sahraouie (APLS), la branche armée du front Polisario, le résultat de tirs à l’arme lourde sur les positions marocaines.
L’objectif, c’est le mur de sable, ce dispositif défensif marocain dont la construction a débuté en 1980 pour éviter les incursions de miliciens indépendantistes, et dont l’agrandissement et le perfectionnement n’ont cessé depuis. Plus de 2 700km de fortifications parcourent le Sahara, de la côte atlantique à la frontière avec l’Algérie. Plusieurs lignes séparées de fossés, entourées de mines, abritant des bunkers, protégées par des radars, des drones, et si besoin est, des unités héliportées et la chasse des forces aériennes royales.
Sur cette fortification coupant en deux le territoire de l’ancienne colonie espagnole du Sahara occidental, les combattants tirent à la mitrailleuse lourde, lancent quelques roquettes Grad installées à l’arrière de pick up dont les cabines ont été sciées à la disqueuse. La plupart des équipements de l’APLS date de la première phase du conflit, entamé à la fin de 1975, et close par le cessez-le-feu de 1991.
Le « mur de la honte »
Les commandants des diverses unités de l’APLS sont tous des vétérans de cette époque. Ils utilisent la seule stratégie à leur disposition : « frapper vite la nuit et le jour pour ne pas laisser les Marocains tranquilles », explique Abba Ali Hamoudi, le chef de la sixième région militaire, la plus proche de leur base arrière algérienne. Blessé sept fois, opéré en France, ce sexagénaire de haute stature est encore là pour ramper avec ses hommes et suivre le déroulement de l’opération qu’il a initiée.
Les combattants sahraouis sont des volontaires, et pour eux ce « mur de la honte » représente une déchirure, une séparation : « Quand je le vois, je pense à mes grands-parents qui sont restés de l’autre côté et que je n’ai jamais vus », nous dit Saïd, caméraman de la télévision sahraouie qui suit et filme les opérations. « La moitié de ma famille se trouve de l’autre côté. Ca me fait beaucoup de mal, clairement. Il faut que nous revenions sur nos terres, il n’y a pas d’autre issue possible », témoigne-t-il.
Parfois, comme sous nos yeux, la défense marocaine réplique. D’autres fois, elle ne s’en donne pas la peine. Le temps d’identifier l’origine de ces tirs, et les combattants sahraouis sont déjà remontés à bord, sillonnant le reg, ce désert rocailleux, sur leurs véhicules. C’est la définition même du conflit asymétrique et de basse intensité. En un an, l’APLS, qui dit tirer chaque jour des roquettes, a perdu une quinzaine d’hommes au combat. Le Maroc n’a jamais communiqué de bilan de son côté.
Un « territoire non-autonome »
Pour le Maroc, l’engrenage n’est pas souhaitable. Le statu-quo permet au royaume de consolider sa mainmise sur ce qu’il appelle les « provinces du sud ». Il contrôle 80% de la superficie de l’ancienne colonie espagnole, et toutes les ressources naturelles : phosphate, pêche, agriculture et tourisme.
Vu de Rabat, le « Sahara marocain » est lié à la monarchie depuis l’époque précoloniale. Si cette proximité historique a été reconnue par la Cour internationale de Justice en 1975, celle-ci a conclu que le droit à l’autodétermination des peuples primait. C’est sur cette base que le Sahara occidental est toujours considéré par les Nations unies comme un « territoire non-autonome », le dernier en Afrique, et que la Cour de justice de l’Union européenne a récemment estimé que les produits venant de cette région ne pouvaient être assimilés à des produits marocains.
De son côté, le Maroc propose une autonomie pour ces provinces sous la souveraineté du roi, et des négociations sous-régionales impliquant l’Algérie, parrain du Polisario, ce que rejette Alger.
Pour les Sahraouis, la perspective est toute autre. Le cessez-le-feu de 1991 avait entrouvert la porte vers un référendum. Mais les années ont passé et la situation n’a pas changé. Le front Polisario, épine dorsale de la République arabe sahraouie démocratique, proto-État en exil dans les camps de réfugiés de la région de Tindouf, en Algérie, a perdu plusieurs de ses soutiens. Mouammar Kadhafi n’est plus là, Fidel Castro non plus, et la révolution n’est plus vendeuse sur le plan diplomatique. Ni l’Algérie, ni les pays de l’Afrique australe n’ont empêché le retour du Maroc au sein de l’Union africaine en 2017.
« La révolution n’est pas une option mais notre responsabilité »
L’immuabilité des positions a bloqué tout le travail diplomatique des différents représentants onusiens, qui ont jeté l’éponge les uns après les autres. Le dernier nommé, Staffan de Mistura, a pris ses fonctions le 1er novembre, après deux ans de vacance du poste.
Autant qu’à Rabat, les cibles du courroux des Sahraouis sont à Paris ou Washington, alliés indéfectibles du Maroc, « qui empêchent le déploiement d’une véritable mission de l’ONU, et l’application du droit international », nous dit un jeune militaire. L’administration Biden n’est pas revenue sur la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. « Notre liberté, personne ne nous la donnera » renchérit un autre combattant, « la révolution n’est pas une option mais notre responsabilité », ajoute Omar Deidh.
Ce jeune homme de 23ans incarne ce que le leadership du front Polisario veut absolument mettre en avant : passionné de sciences politiques et de numérique, il a étudié dans plusieurs pays étrangers, parle parfaitement l’anglais et l’espagnol, mais vient de se mettre au service de l’APLS dont il entend devenir un officier tout en relisant l’exemplaire de L’art de la guerre de Sun Tzu qu’il garde dans la poche de sa veste.
Ces jeunes cadres éduqués, formés, au discours moderne mais aussi capable de s’enflammer pour la défense de leur cause sont opposés aux militaires marocains en faction sur le mur « qui ne sont là que pour un solde minable, et décamperont dès que leur vie sera vraiment en jeu », dixit Omar Deidh.
À quelques heures de piste du mur, s’étendent les camps de réfugiés accueillant depuis 1976 les Sahraouis en exil. Selon les Nations unies, ils étaient 173 600 fin 2017, répartis en cinq wilayas. Ces communes ont pris le nom de villes situées dans ce qu’on appelle ici les « territoires occupés » : Laayoune, Aousserd, Smara et Boujdour encadrent le site administratif de Rabouni. Plus loin vers le sud se trouve Dakhla.
Les populations y survivent grâce à l’aide humanitaire internationale et au soutien matériel de l’Algérie qui a construit les routes, alimente les centrales électriques en hydrocarbure et prend en charge les malades qui ne peuvent être soignés par les hôpitaux sahraouis.
Dans les camps, il nous est difficile de nous déplacer sans un traducteur affilié au front Polisario. Si le mouvement sahraoui n’est pas connu pour réprimer les voix dissidentes, ceux qui acceptent de nous parler savent dans quel contexte ils s’expriment, puisqu’il encadre toutes les facettes de la vie ici.
Néanmoins, le retour à l’état de guerre semble populaire. Il permet de mobiliser une jeunesse qui n’a connu que l’exil, les familles coupées en deux et le fait accompli. Peut-être aussi de canaliser certains candidats à une démarche plus radicale, qui a vu d’anciens réfugiés des camps rejoindre des groupes jihadistes au Sahel, tel Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe Etat islamique tué par les Français mi-août.
« Nous ce qu’on veut, c’est retrouver notre terre »
Derrière une mosquée du camp de Boujdour, la moins peuplée des cinq wilayas, un groupe de jeunes se présentant comme des militaires en congés, nous assurent de leur enthousiasme : « Nous ce qu’on veut, c’est retrouver notre terre. Pour cela, il nous faut nous battre. Moi j’étudiais dans un centre de formation, ici, mais en novembre quand la guerre a repris, j’ai rejoint l’armée. C’est la décision qu’on attendait. »
Des combattants des années 80 ont renfilé leurs treillis, et d’autres ont rejoint les camps d’entrainement du front Polisario. Dans le détachement qui nous accompagnait au front, Ahmed faisait sa première sortie en tant que militaire. Ce père de deux enfants en bas âge sort à peine de formation. Il a pourtant 40 ans : « J’ai travaillé à droite à gauche, dans des commerces, puis dans le bâtiment. Et puis, en novembre, j’ai rejoint l’armée et les camps pour les volontaires. Il y a beaucoup de monde là-bas, beaucoup de jeunes, qui attendaient ce jour, qui étaient frustrés, et d’ailleurs nos centres n’ont pas assez de place pour tant de volontaires » assure-t-il, sachant que nous n’aurons pas les moyens de vérifier cette assertion.
Cet engouement n’est-il pas vain face à la supériorité technique marocaine ? « Nos grands-pères avaient de simples fusils et ils se sont battus quand même. Maintenant on espère que le Polisario trouvera un moyen de nous avoir des armes plus sophistiquées », relativise un jeune de Boujdour.
Certains affirment pourtant que le mouvement indépendantiste a du rompre le cessez-le-feu à son corps défendant, contraint de réagir aux évènements de Guerguerat. À ce poste-frontière avec la Mauritanie, considéré comme une zone tampon par l’accord de cessez-le-feu de 1991, des militants ont en novembre 2020 organisé des sit-in pour protester contre le bitumage de la route par le Maroc, des travaux devant faciliter le trafic des camions. Une « provocation » pour ces volontaires, dont certains n’ont pas hésité à faire six jours de piste et 1 500km pour venir des camps de réfugiés.
Parmi eux, Fatoumata Ment Moyssa nous reçoit pour le thé dans son salon du camp d’Aousserd. Mère et grand-mère âgée de 68 ans, elle est partie dans un convoi d’une soixantaine de personnes sans en référer aux autorités sahraouies : « Ce sont des gens d’ici, des campements, qui se sont organisés. On parlait de ce que faisait le Maroc à Guerguerat, et on a décidé d’aller sur place. On ne peut pas rester éternellement dans cette situation, donc a décidé de faire quelque chose, de manifester. On n’a pas demandé l’avis du gouvernement. On ne nous a pas aidé, mais on ne nous a pas empêché de partir. On ne pensait pas que cela amènerait au retour des hostilités, mais que cela permettrait d’attirer l’attention internationale sur notre situation. »
En ce milieu du mois d’octobre, les écoliers chantent dans les rues, en tenue de fête, des slogans favorables à l’indépendance. C’est la fête de l’Unité, fête nationale de la RASD. L’occasion de souligner et de faire vivre la singularité culturelle sahraouie, la langue hassaniya, les costumes et la musique locales.
« Nous sommes un peuple minoritaire en Afrique du nord », explique Ahmed-Nah, étudiant en France et jeune cadre du Polisario au sein de la diaspora, rentré pour l’occasion, « mais nous sommes plus solides que jamais. Nous n’avons pas la même culture que les Marocains ou les Algériens, alors ce moment de transmission est primordial pour nous ».
Lui aussi veut croire en des lendemains qui chantent : « l’espérance est ici depuis le début et jusqu’à maintenant. Nos grands-parents sont peut-être morts sans avoir vu l’indépendance, mais nous, ou nos enfants, nous verrons ce jour, et ça j’en suis sûr ».
RFI, 15/11/2021
#SaharaOccidental #Maroc #Front_Polisario


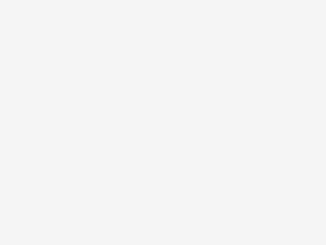
Be the first to comment